#domaine Françoise André
Text
Dégustation : venez redécouvrir les vins de Beaune !
L’association de la Saint-Vincent de Beaune tiendra sa dégustation annuelle samedi 23 mars, au musée du vin beaunois. L’occasion de redécouvrir une appellation encore discrète dans une ville pourtant mondialement connue.
Baptiste Guyot, président de l’association Saint-Vincent de Beaune, et ses confrères vignerons présenteront les vins de Beaune le samedi 23 mars. © ODG Beaune
En partenariat…

View On WordPress
0 notes
Text
Février MMXXIV
Films
Maigret voit rouge (1963) de Gilles Grangier avec Jean Gabin, Michel Constantin, Vittorio Sanipoli, Paul Frankeur, Guy Decomble, Françoise Fabian, Paulette Dubost, Laurence Badie, Roland Armontel et Jacques Dynam
L’Étau (Topaz) (1969) d'Alfred Hitchcock avec Frederick Stafford, Dany Robin, Claude Jade, Michel Subor, Karin Dor, John Vernon, Michel Piccoli, Philippe Noiret et John Forsythe
Flic Story (1975) de Jacques Deray avec Alain Delon, Jean-Louis Trintignant, Renato Salvatori, Claudine Auger, Maurice Biraud, André Pousse, Mario David et Paul Crauchet
Poupoupidou (2011) de Gérald Hustache-Mathieu avec Jean-Paul Rouve, Sophie Quinton, Guillaume Gouix, Olivier Rabourdin, Joséphine de Meaux, Arsinée Khanjian, Clara Ponsot et Éric Ruf
Air Force One (1997) de Wolfgang Petersen avec Harrison Ford, Gary Oldman, Glenn Close, Wendy Crewson, Liesel Matthews, Paul Guilfoyle, William H. Macy et Dean Stockwell
Bob Marley: One Love (2024) de Reinaldo Marcus Green avec Kingsley Ben-Adir, Lashana Lynch, James Norton, Henry Douthwaite, Sevana, Hector Lewis et Tosin Cole
Sister Act (1992) d'Emile Ardolino avec Whoopi Goldberg, Maggie Smith, Kathy Najimy, Wendy Makkena, Mary Wickes, Harvey Keitel, Bill Nunn et Robert Miranda
Astérix : Le Domaine des dieux (2014) d'Alexandre Astier et Louis Clichy avec Roger Carel, Lorànt Deutsch, Guillaume Briat, Alexandre Astier, Alain Chabat, Élie Semoun, Géraldine Nakache, Artus de Penguern, Lionnel Astier et François Morel
Race for Glory: Audi vs. Lancia (2024) de Stefano Mordini avec Riccardo Scamarcio, Daniel Brühl, Volker Bruch, Katie Clarkson-Hill, Esther Garrel, Gianmaria Martini : Hannu Mikkola et Haley Bennett
Buster (1988) de David Green avec Phil Collins, Julie Walters, Larry Lamb, Stephanie Lawrence, Ellie Beaven, Michael Attwell, Ralph Brown et Anthony Quayle
Laura (1944) d'Otto Preminger avec Gene Tierney, Dana Andrews, Clifton Webb, Vincent Price, Judith Anderson, Dorothy Adams et Lane Chandler
Séries
Affaires sensibles
Présidentielle de 1995 : un scandale d'Etat - Michèle Mouton, le Groupe B et les Finlandais volants - Les Ecoutes de la République - La secte du temple solaire, le drame d’une société secrète - Munich 1972 : destin tragique d'un rêve olympique - Les révoltés des Jeux olympiques - Le crash de la Germanwings - Alexandre Litvinenko, victime d’un permis de tuer - Martin Luther King : la naissance d’une icône - Martin Luther King : du rêve au cauchemar - Dans l'ombre de Gérard Lebovici - Macron 2017, le traitre méthodique - Kurt Cobain, portrait d’une génération - Crash au mont Saint Odile
Maguy Saison 1
Rose et Marguerite, c'est le bouquet - Babar et Bécassine se mènent en bateau - Docteur j'abuse - L'union fait le divorce - L'annonce faite à Maguy - Le coupe-Georges - Amoral, morale et demie - Cinquante bougies, ça vous éteint ! - A visage redécouvert'' - Le serment d'hypocrite - Tu me trompes ou je me trompe ? - Comment boire sans déboires - Un veuf brouillé - Le père Noël dans ses petits souliers - L'emprunt ruse - Tous les couples sont permis - L'amant de la famille - Travail, famille, pas triste - Blague de fiançailles - Macho, boulot, dodo - Mi-flic, mi-raisin - Trop polyvalent pour être honnête - La traîtresse de maison - Les trois font la paire - Un grain peut en cacher un autre - La quittance déloyale - Belle-mère, tel fils - Manège à quatre - Comme un neveu sur la soupe - Toutou, mais pas ça ! - A corde et à cri - Jamais deux sans quatre - L'amant comme il respire - Le chômage, ça vous travaille ? - La faillite nous voilà ! - Le divin divan - Toubib or not toubib - L'écolo est fini - Loto, route du bonheur
La croisière s'amuse Saison 2
Un contrat en or - Le Magicien - Copie confuse - Un travail d'équipe - Accrochez-vous au bastingage - Le Célèbre Triangle - Joyeux Anniversaire : première partie - Il y a si longtemps déjà - Passion - Un coup de roulis - Docteur, vous êtes fou - La Petite Illusion - Donne moi ma chance - Qui vivra verra - Réunion de travail : deuxième partie - Méfiez vous de votre meilleure amie - Vague à l'âme - L'amour est aveugle - Chassé croisé
Downton Abbey Saison 6
À l'aube d'un nouveau monde - Le Piège des émotions - En pleine effervescence - Une histoire moderne - Plus de peur que de mal - En toute franchise - Aller de l'avant - Les Sœurs ennemies - Le Plus Beau des cadeaux
Kaamelott Livre IV
Le Jeu de la guerre - Le Rêve d’Ygerne - Les Chaperons - L’Habitué - Le Camp romain - L’Usurpateur - Loth et le Graal - Le Paladin - Perceval fait ritournelle - La Dame et le Lac - Beaucoup de bruit pour rien - L’Ultimatum - Le Oud II - La Répétition - Le Discours - Le Choix de Gauvain - Fluctuat nec mergitur - Le Face-à-face : première partie - Le Face-à-face : deuxième partie - L’Entente cordiale - L’Approbation - Alone in the Dark II - La Blessure d’Yvain - Corpore sano II - L’Enchanteur - Les Bien Nommés - La Prisonnière - Les Paris III - Les Plaques de dissimulation - Le Vice de forme - Le Renoncement première partie - Le Renoncement deuxième partie - L’Inspiration - Les Endettés - Double Dragon - Le Sauvetage - Le Désordre et la Nuit
Coffre à Catch
#153 : Finlay, le retour ! - #154 : Gloire aux Heels ! - #155 : Les débuts historiques de Sheamus ! - #156 : Les Bella Twins arrivent à la ECW ! - #18 ; CM Punk continue d'impressionner & quelqu'un fait du vélo ! - #12 : Le Push de CM Punk + Bsahtek le Bikini !
Castle Saison 4
Sexpionnage - Jeux de pouvoir - Une vie de chien - Le Papillon Blue - Pandore, première partie - Pandore, deuxième partie - Il était une fois un crime - Danse avec la mort - 47 secondes - Au service de sa majesté - Chasseurs de têtes - Mort vivant - Jusqu'à la mort s'il le faut
Les Brigades du Tigre Saison 1
Ce siècle avait sept ans… - Nez de chien - Les Vautours - Visite incognito - La Confrérie des loups - La Main noire
Alfred Hitchcock présente Saison 2, 6
Incident de parcours - Pièce de musée - Reconnaissance
The Grand Tour Saison 5
Trop de sable
La ville Noire
Première partie - Deuxième partie
Les Petits Meurtres d'Agatha Christie Saison 3
Mortel Karma
Spectacles
Monsieur chasse (1978) de Alain Feydeau avec Michel Roux, William Sabatier, Françoise Fleury, Yvonne Gaudeau, Pierre Mirat, Xavier Vanderberghe, Michel Mayou, Bernard Durand et Roland Oberlin
La Bagatelle (1977) de Jean Meyer avec Amarande, Patrick Préjean, Jacques Balutin, Brigitte Chamarande Bel, René Lefevre, Pierre Aufrey et Didier Roussel
Femmes en colère (2023) de Stéphane Hillel avec Lisa Martino, Gilles Kneusé, Hugo Lebreton, Nathalie Boutefeu, Fabrice de la Villehervé, Sophie Artur, Clément Koch, Magali Lange, Aude Thirion et Béatrice Michel
La Pélerine écossaise (1972) de Sacha Guitry avec Jean Piat, Geneviève Casile, Philippe Etesse, Robert Manuel, Raymond Baillet, Françoise Petit, Alain Souchères, Janine Roux et Ly Sary
Livres
Piège de chaleur de Richard Castle
Spirou et Fantasio, tome 15 : Z comme Zorglub de André Franquin, Jidéhem et Greg
Kaamelott, tome 1 : L'Armée du Nécromant d'Alexandre Astier, Benoît Bekaert et Steven Dupré
OSS 117 : Tactique Arctique de Jean Bruce
Astérix, tome 17 : Le Domaine des dieux de René Goscinny et Albert Uderzo
4 notes
·
View notes
Text
“Le Moine noir” d’Anton Tchekhov, traduction du russe Françoise Morvan et André Marcowicz aux Editions Les Solitaires Intempestifs (Adapté par Kirill Serebrennikov au Festival d’Avignon 2022)
par Richard Magaldi-Trichet
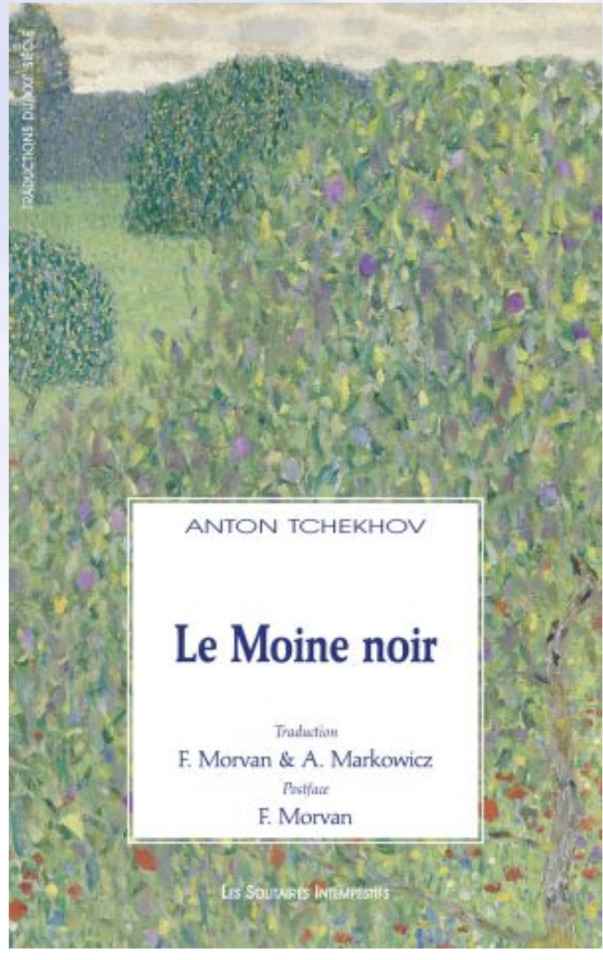
A la recherche de la raison perdue...Comme pour exorciser un mauvais rêve lors d'une sieste d'été 1893, et qui n'aura de cesse de le hanter, Tchekhov nous livre une nouvelle à la lisière du fantastique et de la réflexion philosophique, où « l'agréable inquiétude » du début du récit s'avère finalement « étrange », grincement oxymorique à la conclusion funeste.
Pour se remettre de ce que l'on nommerait aujourd'hui un burn out, le professeur Kovrine vient donc passer quelque jours chez Iégor Pessotski et sa fille Tania, horticulteurs, dans leur magnifique domaine fleuri, « royaume de couleurs tendres, surtout aux premières heures du jour, quand la rosée luisait sur chaque petit pétale ».
Dans ce merveilleux décor, où l'on retrouve toute la musique tchekhovienne dans sa tradition romanesque et poétique, un mystérieux moine noir apparaît à Pessotski, habile à disserter sur sa vision du génie et du bonheur dans un monde où « ne sont bien portants que les êtres médiocres ».
Pris peu à peu au piège de ce jeu de miroirs où il pense entrevoir un sursis à l'obscurité finale de la vie, Kovrine s'aventure malgré lui dans un voisinage de la folie qui lui vaudra la perte fatale de son équilibre.
Sorte de fable où résonne en permanence un memento mori essentiel, Le Moine noir se lit aujourd'hui comme une visitation sacrée, une métaphore du corps et de la maladie où le réel apparaît soudain comme dégrisant et injuste, un basculement imaginaire et magique où, pour reprendre Benjamin Constant, « L'incrédulité est de toutes les choses du monde la plus antipoétique ».
Kirill Serebrennikov, présent au Festival de Cannes 2022 avec son film La Femme de Tchaïkovski, proposera une adaptation de cette remarquable nouvelle dans la Cour d'Honneur du Palais des Papes au Festival d'Avignon ce mois de juillet. On a hâte !

« Le Moine noir » d'Anton Tchekhov, traduction du russe Françoise Morvan et André Marcowicz
aux Editions Les Solitaires Intempestifs
www.solitairesintempestifs.com
Adaptation de Kirill Serebrennikov au Festival d'Avignon
Cour d'Honneur du Palais des Papes du 7 au 15 juillet 2022
www.festival-avignon.com
0 notes
Photo

Pourquoi la musique ? amazon.fr
Broché– 4 février 2015
Couverture : Stéphanie Roujol
Illustration : Henri Matisse, « La Musique (esquisse) » (1907)
© Succession H. Matisse
EAN : 9782213685274
© Librairie Arthème Fayard, 2015.
Du même auteur Francis WOLFF
Notre Humanité. D’Aristote aux neurosciences, Fayard, 2010.
Le Mal nie-t-il l’existence de Dieu ? (en collaboration avec H.-J. Gagey), Salvator, 2008.
Philosophie de la corrida, Fayard, 2007, rééd. Pluriel, 2011. □br>Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? (dir.), PUF, 2007, rééd. 2013.
L’Être, l’Homme, le Disciple. Figures philosophiques empruntées aux Anciens, PUF, 2000.
Dire le monde, PUF, 1997, rééd. 2004. Aristote et la politique, PUF, 1997, rééd. 2008.
Socrate, PUF, 1985, rééd. 2000.
Pourquoi la musique ?
Ce livre est le fruit de la passion d’une vie et de quelques longues années de travail. L’amitié lui doit aussi. Car il aurait été bien plus imparfait sans les observations judicieuses et généreuses de ceux qui se sont donné la peine d’une première lecture : Karol Beffa, Paul Clavier, André Comte-Sponville, Sabine Lodéon, Anne-Sophie Menasseyre de la Visière Bernard Sève. Qu’ils trouvent ici le témoignage d’une reconnaissance publique dont ils n’ont nul besoin. Ils comprendront aisément que ce livre est pour Françoise bien sûr
Au lecteur
Pourquoi la musique ? est un livre de philosophie qui porte sur la musique. Que ceux qui n’ont aucune compétence en ces deux disciplines se rassurent : je me suis efforcé de réduire au maximum le jargon que l’une ou l’autre paraissent exiger. Une des difficultés de ce livre est pourtant qu’il mobilise des concepts philosophiques qui lui sont propres ou certaines notions de théorie musicale réinterprétées de façon parfois inhabituelle. Que le lecteur savant en philosophie ou en musique « oublie » provisoirement ce qu’il sait, et ne fasse confiance qu’à sa perception de la musique ou à la force de conviction des idées ici avancées. Comme tout lecteur, il demeurera seul juge de leur vérité. Il se peut aussi que tel passage apparaisse trop technique à tel ou tel autre lecteur. Qu’il les parcoure rapidement ou les saute sans scrupule. Il trouvera forcément quelques pages plus loin des passages qui lui parleront davantage. La cohérence de ce livre est, je l’espère, suffisante pour supporter quelques élisions de lecture ; les difficultés locales devraient s’éclairer progressivement et trouver leur solution à la fin du parcours.
Il existe des milliers d’études sur le son, le rythme, l’émotion musicale, le sens de la musique, etc. J’ai rarement discuté les diverses théories existantes, ne serait-ce que pour éviter que ce livre, déjà gros, ne le soit quatre fois plus. J’ai donc pris le parti d’exposer directement ma pensée. Je salue avec reconnaissance tous les penseurs que j’ai médités, et dont les écrits, même quand ils soutenaient des thèses opposées aux miennes, m’ont permis de construire mes analyses. Pourquoi la musique ?, enfin, présente des relations étroites avec un travail précédent, Dire le monde (PUF, 1997 ; réédition complétée, PUF, collection « Quadrige », 2004). Ces deux livres forment les volets d’un diptyque : Dire le monde en explorait la dimension logique et Pourquoi la musique ? en expose le pendant esthétique. Mais il n’est nullement nécessaire d’avoir lu Dire le monde pour comprendre le présent livre.
Celui-ci n’est pas l’application d’une grille spéculative construite ailleurs, mais expose une problématique complète et autonome. Comme toute entreprise philosophique telle que je la conçois, elle ne reconnaît d’autre autorité que celles de l’argumentation et de l’expérience – ici celle que nous faisons de la musique.
Car que serait un travail philosophique qui ne s’efforcerait pas de mettre un peu de raison dans notre expérience du monde ?
Et que serait une musique qui ne ferait ni chanter, ni danser, ni pleurer ?
. Des extraits de certaines musiques citées, numérotées de �à Å, peuvent être écoutés sur le site Internet www.pourquoilamusique.fr. Le livre est aussi disponible sous la forme d’un ebook enrichi de ces extraits musicaux. Il y a de la musique, Il y a Bach, Beethoven, Berlioz, Bruckner, Brahms, Bizet, Bartók, Berg, Britten, Berio, Boulez, Beffa, Il y a la cantate, la sonate, la fugue, la symphonie, le concerto, le lied, la messe, l’opéra, l’oratorio, Il y a la musique (dite) contemporaine, sérielle, dodécaphonique, aléatoire, concrète, spectrale, électroacoustique, Il y a les musiques (dites) actuelles, la pop, le rock, le folk, le rap, le heavy metal, la soul, le funk, la house, la techno, Il y a Art Tatum, « Duke » Ellington, Charlie Parker, Miles Davis, John Coltrane (Olé), Ornette Coleman, Il y a la nouba arabo-andalouse, le tchar mezrâb persan, le raga indien, le malouf tunisien, la country américaine, l’afindrafindrao malgache, Il y a la « chanson française », la MPB brésilienne, la « bande originale », la musique légère, Il y a le menuet, la valse, le fox-trot, le charleston, le tango, la rumba, « le » samba, le frevo, la sevillana, Il y a des musiques comme un cri, la seguiriya, une plainte, le blues, une larme, le fado, il y a les chansons d’amour, Il y a l’appel du muezzin, la prière des morts, la psalmodie de l’officiant, Il y a la musique qu’on chante en chœur ou en bande d’occasion, celle qui se scande, celle qu’on accompagne en frappant dans ses mains, en tapant du pied, en criant « ¡ asa ! », en murmurant les paroles, debout, la main sur la poitrine, Il y a des musiques à tout faire, de la musique pour tous usages : pour danser, pour se sentir ensemble, pour s’étourdir, pour se marier, pour accompagner les funérailles, pour communiquer avec les ancêtres, pour cueillir le coton, pour appeler le troupeau, pour souligner un moment de suspense (ou couvrir le bruit du projecteur), pour vendre des cosmétiques, pour apaiser les passagers de l’ascenseur, pour faire pleuvoir, pour arrêter la pluie, pour réveiller la nation, pour marcher au pas, pour aller à la guerre et pour célébrer la paix. Une musique vous poursuit : elle vous peine, vous terrasse, vous désespère, vous exalte, vous enivre. Une autre ne vous dit rien. Il y a des musiques qui donnent envie de croire. Mais à quoi ? Il y a celles qu’on écoute. Simplement. En silence. Partout où il y a des hommes, il y a de la musique. Pourquoi ?
PREMIÈRE PARTIE
Qu’est-ce que la musique ?
On ne peut dire pourquoi il y a de la musique sans définir d’abord ce qu’est la musique. Mais la question « Qu’est-ce que la musique ? » à peine formulée, un doute surgit. Pire : un scrupule. Est-elle « correcte » ? Est-il juste de parler de « la » musique ? N’est-ce pas là une généralisation imprudente ? Ne conviendrait-il pas de respecter la diversité, la richesse, l’infinité des manifestations musicales et de parler « des » musiques, sans préjuger de l’essence ni même de l’existence de quelque chose qui serait « la » musique ?
C’est l’objection des ethnomusicologues : on croit qu’il y a un universel anthropologique là où il n’y a que des particularismes culturels. Après tout, il n’y a peut-être rien qui soit la musique en général, rien de commun entre le Clavier bien tempéré de Bach, le tapage des rituels grecs de possession dionysiaques, la stylisation du chant d’oiseau chez les Kaluli et un concert de Booba. L’objection a une connotation morale : pour nous, « Occidentaux », il y a de la musique. Mais avons-nous le droit de parler de « musique » pour des peuples et des cultures qui ne reconnaissent ni le mot, ni la chose, sans les danses, les chants et tout le rituel religieux ou profane dont elle est inséparable ? Dans certaines langues, comme le sesotho d’Afrique australe, un seul verbe désigne chanter et danser – deux faces d’une même activité. Ce fait traduit d’ailleurs une réalité générale : la majorité des musiques dans l’histoire et dans le monde sont indissociablement des musiques chantées et dansées. C’est à cette seule condition qu’elles peuvent assumer la fonction de coordination des actions motrices et plus généralement de cohésion sociale que lui attribuent les anthropologues. Même le mot mousikè, en grec ancien, d’où dérive notre « musique », ne peut pas être traduit par musique, puisqu’il couvre tout le domaine des Muses, et donc aussi bien la poésie que la danse.
À cette objection ethnomusicologique, il y a trois réponses possibles. Il n’y a d’abord aucun ethnocentrisme occidental à parler de musique comme d’un mode d’expression humaine autonome. Dans toutes les grandes aires civilisationnelles, les « hautes cultures » comme on dit parfois (iranienne, arabe, indienne, sud-est asiatique, indonésienne, chinoise, coréenne, japonaise, éthiopienne, et donc aussi « occidentale » – si l’on tient à ce terme, pourtant nettement plus équivoque que celui de « musique »), il y a de la musique, c’est-à-dire un domaine propre de la culture fondé sur les sons et destiné, entre autres, au loisir. Même la théorie musicale, par exemple la mathématisation, n’a rien d’occidental : on la trouve certes en Grèce ancienne – les Pythagoriciens –, chez les Arabes qui la transmettent à l’Occident moderne, mais aussi dans la Chine ancienne ou en Inde. Toutes les cultures « savantes » connaissent donc de la musique au sens que nous donnons à ce terme ; un grand nombre d’entre elles l’écrivent ; et beaucoup en font la théorie – ce qui retentit sur sa pratique.
Deuxièmement, et plus généralement, on peut bien parler de « musique » dans les petites sociétés traditionnelles, même celles qui n’en reconnaissent pas le concept et dans lesquelles elle ne se sépare pas des autres formes d’expression symbolique. Il en va de même du concept d’art. La plupart des formes d’expression que nous appelons artistiques sont nées dans des sociétés qui ne reconnaissaient pas l’existence de l’art comme tel : les cathédrales, les pyramides, les icônes orthodoxes, les masques dogon, et sans doute Lascaux et Chauvet, ont été produits sans qu’il y ait ni volonté ni même conscience de « faire œuvre d’art », mais seulement d’apaiser les dieux, de leur rendre hommage, de communiquer avec l’au-delà, de manifester sa foi, de prier, etc. Est-ce à dire qu’on n’ait pas le droit de considérer ces manifestations comme ce que nous appelons désormais « art » dans notre langage – qu’on le considère comme porte-parole de l’universel ou comme le mode d’expression de notre tribu particulière ? N’a-t-on pas le droit d’étudier la « religion » de peuples pour lesquels elle ne constitue pas un domaine séparé de l’existence humaine ou qui ne distinguent pas le profane du sacré, ni le laïc du spirituel ?
Et, troisièmement, que répondre à l’objection relativiste ? Les ethnomusicologues ont raison d’insister sur l’extrême variabilité du sens et des fonctions de ce que nous appelons musique. Mais est-ce à dire qu’il n’y a rien de propre et de commun à toutes ces manifestations ? Est-ce à dire qu’il n’y a pas d’universaux de la musique ? L’ethnomusicologie du xxe siècle était une science relativiste par vocation. Une science plus récente, la biomusicologie, est universaliste par méthode. Elle regroupe la musicologie comparée (que pratiquent désormais de nombreux ethnomusicologues) qui étudie les traits universalisables des systèmes musicaux (par exemple la présence d’échelles fixes de hauteurs des notes, la pulsation isochrone, etc.) et des comportements musicaux ; la musicologie évolutionniste qui étudie entre autres l’origine de la musique et les pressions sélectives conditionnant l’évolution musicale de l’espèce humaine ; la neuromusicologie qui étudie les aires cérébrales impliquées dans l’écoute ou la production de musique et l’ontogenèse des aptitudes musicales. L’ethnomusicologie insistait sur l’incommensurabilité des cultures musicales. La biomusicologie redécouvre l’universalité de l’expression musicale humaine.
On peut en conclure : oui, partout où il y a des hommes, il y a bien de la musique, dans le sens que nous, « Occidentaux modernes », donnons à ce terme et quelque sens qu’ils donnent, eux, à cette pratique.
Pourtant l’objection revient sous une autre forme. Il ne s’agit pas simplement de remarquer que la musique est le plus souvent mêlée à d’autres manifestations symboliques ; car non seulement elle n’est pas une pratique clairement délimitée, mais même son concept n’est jamais nettement délimitable. Qu’est-ce qui est musique et qu’est-ce qui ne l’est pas, même « chez nous » ? Dans l’immense majorité des cas, passés et présents, ici comme partout ailleurs, la musique est accompagnée de paroles. Mais dans ce mixte parole-et-musique, où faire passer la frontière, s’il en est une, entre la parole et la musique ?
Considérons un segment horizontal et inscrivons-y, de gauche à droite, tous les modes d’expression sonore depuis la « parole pure » (case 1) jusqu’à la « musique pure » (case 10).
Il y a, entre les deux cases extrêmes et dans tous les genres, une infinité de formes intermédiaires, plus ou moins parlées, plus ou moins musiquées. En (1), nous mettrions mythes, contes, légendes, discours de griot, romans, etc. Mettons en (2) la déclamation (« Entre ici, Jean Moulin… »), le slam, la poésie philosophique, la poésie dramatique et finalement la poésie lyrique. Entre (1) et (2), il faudrait caser les multiples formes de prose rythmée, voire les slogans, politiques ou publicitaires, qui jouent sur les assonances ou les allitérations. En (3), nous pourrions mettre la comptine, la psalmodie, la mélopée antique, le répons (dans le chant grégorien), la cantillation qui soutient la lecture des versets sacrés. La hauteur relative des notes acquiert ici une importance qu’elle n’avait pas en (2). En (4), nous pouvons mettre, par exemple, le récitatif (recitativo secco) de l’opera seria où la ligne vocale doit épouser le débit de la parole et ses inflexions, afin de rendre la dynamique des pensées et des émotions du personnage et de faire avancer le drame. Dans la même case, mais relevant d’un autre moment de l’histoire de l’opéra, on mettrait le Sprechgesang (« chant parlé »), à mi-chemin entre déclamation et chant, celui de Schönberg dans le Pierrot lunaire : le phrasé y compte plus que la mélodie. On pourrait mettre, non loin, les joutes traditionnelles d’improvisation poético-musicale comme la cantoria du Nordeste brésilien ou le trovo andalou. Peut-être pourrait-on y joindre certaines performances de Billie Holiday, lorsqu’elle est la plus poignante, c’est-à-dire quand elle semble soliloquer. Ajoutons-y le rap, ou la technique du « parlé-chanté » de certains chanteurs français (Serge Gainsbourg, Barbara, Alain Bashung) ou de certains groupes de rock [écouter Patti Smith chanter « Gloria » �ou encore son déchirant « Birdland », l’un et l’autre dans son album Horses]. À l’autre bout de notre histoire et de l’échelle reçue des valeurs esthétiques et spirituelles, le plain-chant pourrait entrer dans cette catégorie. Dans cette case (4), aux frontières forcément floues, le trait essentiel d’expressivité est l’intonation du texte, qui se détache sur le fond de certains traits de musicalité. Par exemple, dans le récitatif, le « contour » mélodique est privilégié, quoiqu’il suive au plus près les intonations de la parole, la mesure est libre et l’accompagnement instrumental réduit au minimum ; dans le rap, c’est la scansion rythmique qui est privilégiée ; dans le plain-chant, il n’y a pas du tout d’accompagnement instrumental, aucune polyphonie et le chant est non mesuré.
Avec les cases centrales (5) et (6), la fusion texte et musique s’opère, et leurs éléments propres d’expressivité tendent à s’équilibrer, plus favorables au texte en (5), plus favorables à la musique en (6). La case (5) marquerait la naissance du chant. Mettons-y le blues originel [écouter Robert Johnson, par exemple « Sweet Home Chicago ➋], la saeta andalouse chantée lors de la semaine sainte [écouter par exemple « Maria tu no conoces » par Canalejas de Puerto Real ➌], la plupart des musiques country des États-Unis ou sertaneja au Brésil ; en musique classique, le récitatif accompagné de l’opera seria se distingue du « sec » de la case précédente par un accompagnement d’orchestre et une plus grande autonomie de la ligne de chant par rapport à l’intonation parlée, et même, parfois, des ornementations vocales. Entre (5) et (6), on placera le « récitatif mélodique » du Pelléas et Mélisande de Debussy, ou l’arioso, la « mélodie infinie » de Wagner. Par différence, on mettrait dans la case (6) l’aria d’opéra. La fusion du texte et de la musique s’opère cette fois par l’autre bout. Les exigences de structure propres à la composition musicales d’un air (par exemple la répétition, la reprise thématique, voire la structure A-B-A de l’aria da capo) l’emportent sur la dynamique dramatique qui est, elle, linéaire et irréversible. La musique exprime par ses moyens ce que le texte dit dans son médium, mais la temporalité et la forme musicales l’emportent. Ces airs, on peut les siffloter, les chantonner, les retenir facilement. Plaçons dans cette case la « mélodie française » (Debussy, Fauré), le lied allemand, la ballade jazz, les chœurs des cantates sacrées et tout ce qu’on appelle les « chansons » (monodies harmonisées), avec leur alternance de couplets et de refrains – forme dite en rondo. On pourrait nuancer, et mettre Brassens ou une aria de Monteverdi plus « à gauche » (quelque part entre 6 et 5 !) et Les Beatles ou Verdi plus « à droite », débordant vers (7). Et encore ! Falstaff est plus près de (5) et La Traviata plus près de la case (7). Celle-ci est symétrique de la (4), celle du récitatif, mais cette fois la musique « domine », et quand le texte intervient, c’est à condition de s’intégrer parfaitement à une mélodie dont la forme est musicalement prédéterminée : tel est le cas des mouvements de symphonie avec chœur ou avec voix, la Neuvième de Beethoven, la Deuxième de Mendelssohn « Lobgesang » (« Chant de louanges »), les Deuxième, Troisième, Quatrième et Huitième de Mahler, sans doute les représentants symphoniques les plus typiques de cette case. Dans un autre genre, on y ajoutera toutes ces sessions de jazz pendant lesquelles telle chanteuse « prend son chorus » de 32 mesures, ni plus ni moins qu’un instrumentiste de big band. Mais la meilleure illustration jazzique de cette contrainte du texte par la musique est le style de chant dit vocalese : des paroles sont composées (parfois même improvisées) pour correspondre très exactement à la ligne mélodique préexistante et déjà enregistrée d’un solo instrumental [écouter Eddie Jefferson, « Body and Soul » ➍].
Le texte lui-même peut s’effacer plus ou moins complètement au point de disparaître. C’est ce qui se passe dans le style de chant opposé au vocalese, le scat, qui aurait parfaitement sa place dans une case (8) et dont Louis Armstrong et Ella Fitzgerald sont les maîtres [écouter les fameux « How High the Moon » ➎ ou « Oh Lady Be Good »]. Il n’y a plus de texte, seulement des onomatopées (bap ba dee dot bwee dee) et la voix est traitée comme un instrument. Situation connue dans le chant classique, l’improvisation en moins : qu’on écoute les vocalises insérées dans des airs de virtuosité, depuis les opéras baroques de Haendel jusqu’aux « grands airs » de bel canto, en passant par Rossini ou Mozart (la Reine de la nuit de la Flûte enchantée). Il y aurait aussi la réinterprétation des œuvres instrumentales de Bach par les Swingle Singers ou les chabadabada de Pierre Barouh dans Un homme et une femme. Dans les musiques populaires, pensons, par exemple au jodl tyrolien, aux chants de gorge (inuit, tibétain), aux chants diphoniques des Mongols, à l’ayeo du flamenco (l’introduction d’un cante jondo par une voyelle psalmodiée pour en installer le climat), les mélismes ornementaux des chants arabe ou andalou, etc.
La situation de la case (8) est symétrique de celle de la case (3). En effet, par opposition à (8), l’harmonie et la mesure sont absentes dans la psalmodie de (3) ; il ne reste de la mélodie qu’un contour vague et de la dynamique musicale que des accentuations sur quelques consonnes privilégiées au service du discours. C’est le contraire dans la vocalise ou le scat de (8) : le texte a disparu et il ne reste de la parole que les inflexions vocales, exprimant au moyen de quelques voyelles privilégiées telle ou telle émotion, l’effervescence, la jubilation, le ravissement ou la colère, la malédiction, la folie, etc., et souvent, le simple délice de la virtuosité.
Dans la case (9), même la voix, instrument de la parole, a disparu. Pourtant, il peut rester dans la musique elle-même quelque chose d’un discours : comme une description parfois (le leitmotiv wagnérien), comme un récit souvent. Telle est l’ambition de la musique « instrumentale à programme », par exemple les poèmes symphoniques de Franz Liszt. On dira, avec raison, qu’on peut apprécier ces morceaux sans savoir ce qu’ils racontent et les entendre comme de la musique « pure ». C’est vrai. Il en va de même, mutatis mutandis, des textes de la case (2). On peut n’entendre dans la poésie philosophique de Lucrèce que la philosophie épicurienne, sans se soucier de l’hexamètre dactylique qui la porte ; on peut n’entendre Phèdre de Racine que comme un drame, ce n’est pas un contresens. Mais il est absurde de prétendre que le vers lucrétien ou racinien ne sont pour rien dans la force expressive de ces poèmes ; et il l’est tout autant d’affirmer que la narration qui sous-tend L’Apprenti sorcier de Paul Dukas ou de Une nuit sur le mont-Chauve de Modeste Moussorgski ne contribue nullement à la puissance expressive de ces poèmes symphoniques : Fantasia de Walt Disney n’est pas une trahison ! On ne peut prétendre comprendre complètement une tragédie de Racine sans entendre la musique de ses vers ; on ne peut prétendre comprendre complètement L’Apprenti sorcier sans en entendre la structure narrative (introduction, développement, drame, reprise, final), et percevoir les thèmes qui s’affrontent ou se mêlent (mélodie du balai et joie de l’apprenti) et dont les harmonies se modifient selon les états d’âme du personnage : doute, peur, frayeur, etc.
Reste donc à la case (10) : musique « pure », sans parole, sans voix, sans prétention descriptive ou narrative. À côté de quelques musiques traditionnelles instrumentales, on y trouverait une bonne partie de la musique classique depuis la fin du xviiie siècle (sonates, concertos, symphonies, quatuors à cordes, etc.), l’essentiel du jazz, la techno, etc.
Ainsi, toutes les formes de fusion parole-musique sont possibles et s’inscrivent sur un continuum. Et finalement, les formes d’expression extrêmes (littérature sans aucun trait de musicalité, musique sans aucun texte) sont les plus rares. En outre, chaque forme est parfaite en son genre, non au sens où elles se vaudraient toutes mais où aucune ne manque de quoi que ce soit : les formes plus à gauche ne sont pas plus « privées de musique » que celles plus à droite sont « privées de parole ».
De ce schéma, trois lectures sont possibles, toutes discutables. Elles renvoient à trois conceptions de la musique.
La première lecture serait diachronique et évaluative. De gauche à droite, il y aurait comme un sens de l’histoire. Ce vecteur reflèterait l’évolution de la musique savante jusqu’au xixe siècle : la conquête par la musique de son autonomie, s’émancipant lentement de la parole. Achevant son parcours et son devenir, elle ne servirait plus aucun maître : ni les festivités royales ou princières, ni les divertissements populaires, ni la liturgie, ni le théâtre, ni (donc) le Verbe : de (1) à (10), la musique est enfin devenue absolue ! Triomphe de la Forme éthérée des sons sur le poids des mots. C’est du moins ce que pensaient certains théoriciens et musiciens du xixe siècle. En devenant purement instrumentale, la musique serait libérée de tout assujettissement à un autre médium. Elle serait finalement elle-même. C’est, au xixe siècle, Brahms ou Mendelssohn contre Liszt et Wagner. Au xxe siècle, c’est la lutte des compositeurs formalistes contre les facilités de la musique illustrative. Selon cette lecture, la musique, la vraie musique, se trouverait dans la case (10), tous les modes précédents d’expression n’étant que des approximations de cette essence réalisée. La musique serait l’aboutissement d’une quête d’autonomie. Une deuxième lecture de notre tableau est pratiquement inverse de la précédente. Elle serait moins généalogique qu’archéologique. Ou même paléoanthropologique. Il faudrait lire diachroniquement le tableau, non pas de gauche à droite mais à partir du milieu, si l’on peut dire. La fusion quasi-universelle de la musique et de la parole attesterait d’une origine commune. La forme archaïque de la communication humaine ne serait ni linguistique, ni musicale, mais plutôt « musilinguistique ». Selon certains biomusicologues, le proto-langage et la proto-musique auraient ainsi été originellement fondus dans un seul médium, le « musilangage » qui aurait conjoint (encore très grossièrement) leurs pouvoirs respectifs. Deux points communs actuels témoigneraient de cette fusion primitive : syntaxique et sémantique. Dans le langage comme dans la musique, l’unité fonctionnelle de base de la « communication » serait la phrase, articulation diachronique d’unités sonores discrètes, notes ou phonèmes. Qu’elle soit linguistique ou musicale, la phrase s’oppose ainsi au grognement ou au cri. En outre, ces deux médiums servent l’un et l’autre à communiquer et à exprimer des « pensées » entre humains au moyen de sons vocaux – lesquels ont été ensuite médiatisés par des instruments ou par l’écriture. Il y aurait donc une forme originaire unique avant séparation et spécialisation : au langage proprement dit, la communication des « informations » ; à la musique, celle des « états d’âme ». Dans cette seconde lecture, la musique serait un mode universel d’expression des émotions difficilement séparable du langage, sinon tardivement et pour ainsi dire artificiellement.
On proposera une troisième lecture, d’abord par réfutation des deux précédentes. On se défiera de leurs spéculations historiques ou archéologiques. On s’en tiendra alors prudemment à une lecture synchronique du schéma et à une vision égalitaire de ses cases. À la première interprétation, on refusera l’idée que la musique « pure » serait meilleure ou plus « évoluée » que les autres formes, mais on retiendra au moins que cette forme existe, et qu’elle est donc possible ! Il y a de la musique pure. De là une question : comment est-ce possible ? Et une règle heuristique : toute réflexion sur le sens, la valeur, la raison d’être de la musique en général, devra s’appuyer de façon privilégiée sur cette musique pure : non pas parce qu’elle est plus musique que les autres, mais parce qu’elle l’est autant, et que des réponses qui ne lui seraient pas applicables ne seraient valables pour aucune autre.
L’idée que la musique ne serait qu’une espèce lointainement dérivée d’un genre plus fondamental – le « musilangage » – laissera perplexe, du moins en attente de preuves empiriques dont on se demande bien en quoi elles pourraient consister. Cependant, on retiendra de la seconde interprétation l’idée qu’il y a différents degrés de musique (ou de musicalité). La musique ne serait pas une essence pure, elle ne désignerait pas toujours une entité déterminée mais une propriété variable. C’est à cette musique-propriété que Verlaine se réfère dans l’« Art poétique » quand il écrit « De la musique avant tout chose… », parlant des rythmes et des sonorités. Il y aurait de la musique, sinon partout, du moins ailleurs que dans la musique – ailleurs que dans la musique-entité, et d’abord dans la poésie, voire dans la danse et, pourquoi pas ?, de proche en proche, dans toutes les activités qui comportent rythmes ou vocalisations. De là deux questions : comment mesurer ce plus et ce moins de musicalité par lesquels se définirait la musique ? Y a-t-il un seuil où commence la musique-entité ? Et une autre règle heuristique : aucune comparaison empirique entre les différentes cases du tableau ne permettant de répondre à ces deux questions, il faudra recourir à un autre type d’expérience, une « expérience de pensée », et à un autre type de méthode, proprement philosophique, une méthode déductive.
Quelle que soit la lecture qu’on en fasse, ce tableau nous confirme bien que « la » musique existe. Elle est donc bien quelque chose. Mais quoi ?
© 1996-2019, Amazon.com, Inc. ou ses filiales.
0 notes
Photo

« Dix pour cent » : qui sont les vrais agents d'acteurs qui se cachent derrière les personnages ?
Après les avocats ou les médecins, les agents artistiques ont leur série, inspirée de la vie de Dominique Besnehard, le plus célèbre d'entre eux. Des pros à tout faire, face aux caprices des stars qu'ils cajolent. Savoureux.
Pendant vingt-deux ans, Dominique Besnehard s'est couché tous les soirs en se sentant coupable. « Etre un agent artistique, explique l'ami des vedettes, c'est devenir le réceptacle des angoisses des acteurs et des actrices dont on défend les intérêts. On ne peut jamais s'empêcher de penser que l'on aurait pu décrocher un rôle plus intéressant ou leur obtenir un plus gros cachet. » L'ex-star des agents a abandonné « ce métier dévorant » en 2007, mais rêvait, depuis, de le raconter dans une série glamour. « Autant de passions et de névroses, c'est un réservoir formidable pour la fiction », s'amuse le coproducteur de Dix pour cent — le titre fait référence au pourcentage de leurs cachets que les « talents » sont tenus de reverser à leur agent pour rémunérer ses services
Les souvenirs de Dominique Besnehard constituent la base des six épisodes, diffusés sur France 2 à partir de mercredi. Fanny Herrero et son équipe d'auteurs (à 70 % féminine) ont articulé ses anecdotes savoureuses — et garanties authentiques —, dans un récit sur le quotidien et les déboires d'une agence artistique plus vraie que nature. « Dix pour cent est une série "professionnelle" comme il en existe sur les cabinets d'avocats, les hôpitaux ou les commissariats, explique la scénariste. A cette différence près que le milieu des agents est inconnu des téléspectateurs. » Le projet est atypique, poursuit Dominique Besnehard : « Il faut faire rêver le public avec le monde du spectacle, mais il doit pouvoir aussi s'identifier à ce monde, y retrouver son propre vécu. » Modèle revendiqué : Suits, avocats sur mesure, la série judiciaire qui est parvenue à rendre divertissant un domaine aussi hermétique que le droit des affaires.
Dix pour cent se situe ainsi dans le registre de la « dramédie », un mélange d'humour (dans une proportion évaluée par nos soins à 85 %) et de situations dramatiques. A la fin du premier épisode, la mort tragiquement drôle du président-fondateur de l'agence ASK va bouleverser les relations entre ses quatre associés, par ailleurs confrontés aux caprices plus ou moins baroques de leurs clients. Quatre personnalités aux profils très différents, et inspirées par d'authentiques agents (lire ci-dessous). « C'est un métier de l'ombre, analyse Fanny Herrero. La principale difficulté était de trouver un ton assez universel pour le rendre compréhensible au plus grand nombre. » L'astuce ? Un personnage de (faux) candide : Camille (interprétée par Fanny Sidney), la fille cachée du numéro 2 de l'agence ASK, parvient à se faire engager comme assistante de l'associée (et néanmoins rivale) de son père. Son apprentissage permet de faire découvrir avec humour la dimension « couteau suisse » du métier d'agent. Qui, en plus de négocier les contrats, est aussi lobbyiste, chasseur de têtes, concierge de luxe, psy (« les acteurs sont les êtres les plus inquiets au monde », note avec lucidité Grégory Montel, qui incarne l'un des agents), ou diplomate — réplique clé du premier épisode : « On ne ment pas à une actrice, on lui cache la vérité. »
Originalité de la série, chaque épisode a son « guest », ou son duo de « guests » : des acteurs et actrices de renom dans leur propre rôle... et pas toujours à leur avantage. Malgré le carnet d'adresses de Dominique Besnehard, convaincre les stars du septième art de participer à Dix pour cent n'a pas été simple. « Les acteurs ont l'habitude d'être servis au cinéma, note avec humour Fanny Herrero. Là, ils devaient se mettre au service d'autres, les agents. » Cédric Klapisch, directeur artistique et coréalisateur de la série, assure avoir essuyé « entre vingt et trente refus, surtout de la part d'hommes ». Motif le plus souvent avancé ? « Je ne peux pas jouer mon propre rôle... » Dominique Besnehard n'a pas été surpris : « Les stars françaises ont plus de mal avec l'autodérision que les Anglo-Saxons. S'amuser avec leur image publique leur fait peur. »
Conséquence de ces forfaits, parfois de dernière minute : certains scénarios, imaginés pour tel ou tel comédien, ont dû être réécrits. Faute de volontaires, le couple père-fils du troisième épisode est ainsi devenu... un couple mère-fille, avec Nathalie Baye et Laura Smet découvrant, horrifiées, qu'elles vont devoir jouer dans le même film ! Les deux actrices, dont la relation est beaucoup plus apaisée à la ville qu'à l'écran, ont accepté immédiatement la proposition très ludique de Dix pour cent. Même absence de complexes de la part de Cécile de France, qui, pour les besoins du scénario, doit pourtant subir un lifting pour jouer dans le prochain Tarantino. Les autres courageux se nomment Line Renaud et Françoise Fabian, visiblement ravies de se crêper le chignon, Audrey Fleurot (aussi drôle que touchante en comédienne qui tente de conjuguer carrière et maternité), le couple improbable Julie Gayet-JoeyStarr (dont la guerre ouverte sur un plateau de tournage contraint leurs agents respectifs à jouer les Casques bleus), et François Berléand. Très crédible dans les attitudes d'un comédien capricieux, ce dernier tacle gentiment ses petits camarades. « Si certains ont refusé de participer à Dix pour cent, c'est peut-être parce que le rôle n'était pas assez important. Moi, je me suis régalé à jouer un personnage détestable, parce que je ne suis pas du tout comme ça ! »
Fanny Herrero espère que la diffusion des six épisodes calmera les craintes des stars frileuses. Et leur donnera envie de rejoindre le générique de la deuxième saison, dont les grandes lignes narratives ont déjà été validées par France 2. Après la projection en avant-première de Dix pour cent au Festival du film francophone d'Angoulême, acteurs et actrices étaient nombreux à féliciter Dominique Besnehard en lui glissant à l'oreille : « Pense à moi pour la prochaine saison ! » Mais l'heureux producteur reste prudent : « Entre vouloir apparaître à l'écran et s'y voir, il y a un monde... »
QUI SE CACHE DERRIÈRE LES PERSONNAGES ?
Gabriel
Le passionné. Il est tout dévoué à ses client(e)s. Au point de vivre toute dispute avec eux comme un drame : quand un « talent » le quitte, c'est comme une rupture amoureuse. « C'est un mélange de Laurent Grégoire, le fondateur de l'agence Adéquat (qui travaille pour Marion Cotillard, Omar Sy...), et de moi-même, reconnaît Dominique Besnehard. Nous ne savons pas quoi faire en dehors de ce métier. » Même si, selon son interprète, Grégory Montel, « Laurent Grégoire s'est plutôt reconnu dans le personnage d'Andréa »...
Andréa
La pasionaria du cinéma d'auteur. Exigeante, séduisante, à l'homosexualité affichée. Son modèle ? Elisabeth Tanner, l'une des vedettes de la profession (agente de Sophie Marceau, André Dussollier, Charlotte Rampling...), ex-numéro 2 de l'agence Artmedia et présidente du Syndicat français des agents artistiques et littéraires. « Andréa est son portrait craché, assure Besnehard. Camille Cottin a même repris ses gestes."
Mathias
L'ambitieux. Il incarne la dimension « business » du métier. Pour Besnehard, le personnage a deux sources d'inspiration : Bertrand de Labbey, le patron de la plus puissante agence artistique d'Europe, Artmedia (à son catalogue : Catherine Deneuve, Gérard Depardieu, Jamel Debbouze...), et François-Marie Samuelson, spécialiste de « coups » dans l'édition littéraire et, pour le cinéma, agent de Juliette Binoche et Mathieu Kassovitz.
Arlette
La doyenne de l'agence, et sa mémoire. A commencé sa carrière à l'époque où les agents s'appelaient des « imprésarios ». « Elle a été inspirée par Josette Arrigoni, l'une des légendes du métier, aujourd'hui en retraite, qui a été la secrétaire de Gérard Philipe avant de devenir l'agente d'Annie Girardot et de Jean Rochefort, raconte Besnehard. Physiquement, c'est une dame un peu fragile, un vrai petit oiseau. Le personnage d'Arlette est plus dur... »
🎬 🎥 🎞️ 📽️ 🎬 🎥 🎞️ 📸 📽️ 🎬
https://www.telerama.fr/series-tv/dix-pour-cent-une-nouvelle-serie-100-show,132427.php
0 notes
Text
A l’instar des institutions et des mentalités, le cinéma français n’a pas échappé à l’influence de Mai 68. Les années qui suivirent ce printemps historique furent, dans ce domaine, celles d’une irrésistible évolution vers la permissivité.
La période qui s’étend de 1969 à 1974 forme une période historique assez homogène, celle qu’un critique français, Jean-Pierre Jeancolas a pu baptiser “les années Pompidou”. Des années, dit-il, « où le calme apparent, la torpeur et la morosité de surface cachaient des mouvements de profondeur, des mutations à la fois sociales et mentales ». Ces mouvements profonds, le cinéma français les a enregistrés à sa manière, du cinéma politique d’après Mai 68, dont la secousse se prolongea assez longtemps, jusqu’à celui de la « permissivité », autre conséquence directe du fameux printemps parisien, qui devait déboucher sur la vague de cinéma pornographique des années 1973-1975, au terme d’une escalade aussi logique qu’irrésistible. Mais à côté de ce cinéma aux couleurs de l’époque continua de subsister, comme si de rien n’était, une production courante qui eut pour fonction, comme par le passé, et avec un succès inchangé, de satisfaire les goûts du grand publIc, un public toujours désireux de voir des films qui lui fassent oublier les problèmes du temps, bien plus que d’y trouver des interrogations nuisibles à son confort intellectuel.
L’HORLOGER DE SAINT-PAUL de Bertrand Tavernier (1974) avec Philippe Noiret, Jean Rochefort, Jacques Denis
LA TRAQUE de Serge Leroy (1975) avec Mimsy Farmer, Jean-Pierre Marielle, Michael Lonsdale, Michel Constantin, Philippe Léotard
Z de Costa-Gavras (1969) avec Jean-Louis Trintignant, Yves Montand, Irène Papas, Jacques Perrin
EMMANUELLE de Just Jaeckin (1974) avec Sylvia Kristel Alain Cuny
COUSIN COUSINE de Jean-Charles Tacchella (1975) avec Marie-Christine Barrault, Victor Lanoux, Marie-France Pisier
LACOMBE LUCIEN de Louis Malle (1974) avec Pierre Blaise et Aurore Clément
MOI Y’EN A VOULOIR DES SOUS de Jean Yanne (1973) avec Bernard Blier, Nicole Calfan, Michel Serrault, Fernand Ledoux, Jean-Roger Caussimon, Daniel Prévost
LA NUIT AMERICAINE de François Truffaut (1973) avec Jacqueline Bisset, Jean-Pierre Léaud, Jean,Pierre Aumont, Valentina Cortese
L’AMOUR L’APRES-MIDI d’Éric Rohmer (1972) (sixième et dernier volet des Six contes moraux) avec Bernard Verley, Zouzou, Françoise Verley, Daniel Ceccaldi
GLISSEMENTS PROGRESSIFS DU PLAISIR d’Alain Robbe-Grillet (1974) avec Jean-Louis Trintignant, Anicée Alvina, Olga Georges-Picot, Michael Lonsdale
LES VALSEUSES de Bertrand Blier (1974) avec Gérard Depardieu, Patrick Dewaere, Miou-Miou, Jeanne Moreau, Brigitte Fossey, Isabelle Huppert
LE CERCLE ROUGE de Jean-Pierre Melville (1970) avec Alain Delon, André Bourvil, Gian Maria Volonte, Yves Montand, François Périer
L’esprit militant
Le cinéaste le plus représentatif des courants qui agitent alors la société française est certainement Jean-Luc Godard. Après avoir génialement annoncé, avec presque un an d’avance, ce qu’allait être Mai 68, dans La Chinoise (1967), après avoir vécu intensément cette période, Godard s’en fit le chroniqueur et le propagandiste dans des films marginaux, réalisés plus ou moins collectivement ou en collaboration (avec Jean-Pierre Gorin, le plus souvent) et qui ne connurent en général qu’une diffusion de circuits parallèles, comme Le Gai Savoir (1969), Le Vent d’Est (1970), Pravda (1970), Vladimir et Rosa (1971), etc. Cette première période « underground » prit fin avec un retour à la production normale, à l’occasion de Tout va bien (1972), interprété par Jane Fonda et Yves Montand. Après l’échec de ce film, Godard reprit ses expériences, se retira en province, s’essaya à la vidéo, et sacrifia même à la mode du porno en incluant des scènes « hard » dans Numéro deux (1975) réalisé avec Anne-Marie Miéville. Cette période d’errances se poursuivra jusqu’à l’orée des années 80. Itinéraire exemplaire d’un cinéaste fidèle à lui-même et à ses prises de position, et qui n’a cessé d’intriguer ses confrères et de malmener le public.
Autre cinéaste politique, à la trajectoire plus cohérente que celle de Godard, Chris Marker ressentit également profondément les événements de Mai 68. Associé successivement aux « collectifs » SLON et ISKRA, il avait dès 1967 filmé une grève dure à Besançon avec A bientôt, j’espère, au titre prophétique. Il y aura ensuite, notamment, La Bataille des dix millions (1971), Le Train en marche (1971), La Grève des travailleurs de Lip (1974), etc. Tout cet effort trouvera son aboutissement dans Le fond de l’air est rouge (1977), puissante synthèse politique, d’un grand non-conformisme, sur les années récentes.
De son côté, le groupe ISKRA poursuivit son activité, dans l’esprit du cinéma militant, issu de Mai 68 et des États généraux du cinéma français qui avaient donné l’impulsion et publié des manifestes énergiques. Plusieurs groupes du même genre fonctionnèrent un certain temps, mais aucun ne révéla un nouveau Marker. D’autres cinéastes réagirent différemment, ainsi Louis Malle qui partit pour l’Inde, d’où il rapporta d’intéressants documentaires comme Calcutta (1969) et L’Inde fantôme (1969), avant de se faire, à son tour, l’explorateur de la société française, avec Humain trop humain (1974) sur les usines Citroën, et Place de la République (1974), sortes de reportages sociologiques qui rencontrèrent beaucoup moins de succès qu’un film à scandale, Le Souffle au cœur (1971). Malle ne reviendra au premier plan qu’avec Lacombe Lucien (1974), une des œuvres qui contribuèrent le plus à la fameuse mode « rétro » qui devait caractériser le début de la période suivante.
Au nombre des produits de Mai 68, on rangera encore Marin Karmitz, avec Camarades (1969) et Coup pour coup (1972), films engagés qui n’échappèrent pas à l’accusation de démagogie de la part même des milieux auxquels ils s’adressaient, et ce que la suite de la carrière du cinéaste sembla confirmer. Vétéran des luttes clandestines, René Vautier trouva dans le climat de ces années l’occasion de refaire surface, avec Avoir vingt ans dans les Aurès (1972) et La Folle de Toujane (1974).
TOUT VA BIEN – écrit et réalisé par Jean-Luc Godard et Jean-Pierre Gorin (1972) avec Yves Montand, Jane Fonda
LE SOUFFLE AU COEUR de Louis Malle (1971) avec Benoît Ferreux, Lea Massari, Daniel Gélin, Michael Lonsdale
COUP POUR COUP, film documentaire français militant réalisé par Marin Karmitz (1972)
LA GREVE DES TRAVAILLEURS DE LIP de Chris Marker (1974)
Sur fond de politique
A la faveur du climat ainsi créé, on vit se constituer un cinéma politique moins confidentiel, plus délibérément commercial, et recherchant par divers moyens (gros budgets, vedettes, recours à une actualité d’exploitation plus facile) l’audience du public le plus large, généralement avec succès. Ainsi firent Costa-Gavras, avec Z (1969), histoire de l’assassinat d’un homme politique grec de gauche et avec L’Aveu (1970), inspiré de l’autobiographie d’Arthur London consacrée aux purges communistes, ou Yves Boisset avec L’Attentat (1972), film sur l’affaire Ben Barka, R.A.S. (1973) sur la guerre d’Algérie et Dupont Lajoie (1974) sur le racisme ordinaire des Français. Dans la même lignée, encore que d’une orientation politique différente, on peut mentionner Le Complot (1973) de René Gainville, consacré à l’O.A.S. et aux complots des « activistes » Algérie française, dans lequel Jean Rochefort incarne une belle figure d’ «officier perdu» unique dans le cinéma d’alors.
La politique apparaît aussi, avec plus ou moins d’acuité selon les cas, dans certains films de Claude Chabrol, qui tourne beaucoup au cours de la période : une dizaine de films entre 1969 et 1974. Parmi les meilleurs : Le Boucher (1970), Juste avant la nuit (1971), Les Noces rouges (1973). Ce dernier est sans doute le plus directement politique, avec Nada (1973) d’un niveau inférieur. Dans Les Noces rouges, fait divers criminel, les protagonistes sont des personnages politiques (appartenant à la majorité gaulliste), et l’intrigue évoque certains scandales immobiliers, comme il en pullulait alors. Malgré les outrances habituelles de Chabrol, le film n’est pas dépourvu d’une certaine vérité. Plus conventionnel apparaît Nada, qui s’en prend aux réseaux terroristes d’extrême gauche et aux captures d’otages. Cette fois le romanesque l’emporte nettement sur la vérité sociale et l’observation.
On trouve des références plus exactes à la réalité politique et sociale dans La Race des seigneurs (1974) de Pierre Granier-Deferre, adapté par Pascal Jardin d’un roman à succès de Félicien Marceau. Alain Delon y campait avec autorité un « jeune loup » de la politique, comme la Ve République en a produit beaucoup. La Horse (1970), dû à la même équipe Granier-Deferre et Pascal Jardin, contenait aussi des allusions précises à des débats idéologiques contemporains, ce qui n’est plus le cas des autres films réalisés par le même duo.
Enfin, on rattachera, un peu artificiellement, au cinéma politique les films de Jean-Pierre Mocky, dont la verve caricaturale et un anarchisme foncier et volontiers salace rendent l’auteur difficile à situer. Tournant beaucoup au cours de la période, il a réalisé notamment : Solo (1969), L’Étalon (1969), L’Albatros (1971) et Chut ! (1972). Mais aucun de ses films, pas tous réussis, ne saurait laisser indifférent.
L’AVEU de Costa-Gavras (1970) adapté du livre du même nom d’Artur London avec Yves Montand, Simone Signoret, Michel Vitold
DUPONT LAJOIE d’Yves Boisset (1974) avec Jean Carmet, Jean Bouise, Pierre Tornade, Ginette Garcin, Jean-Pierre Marielle, Isabelle Huppert
LES NOCES ROUGES de Claude Chabrol (1973) avec Claude Piéplu, Michel Piccoli, Stéphane Audran
LA RACE DES SEIGNEURS de Pierre Granier-Deferre (1974) avec Alain Delon, Sydne Rome, Jeanne Moreau
L’ETALON de Jean-Pierre Mocky (1970) avec Bourvil, Francis Blanche, Jacques Legras
En marge
Une autre conséquence de l’éclatement des structures de l’ancien cinéma, accéléré sinon provoqué par la secousse de Mai 68, fut, à l’opposé d’un cinéma engagé, voire militant, l’apparition d’une tendance ultra-formaliste, résolument marginale, et s’en prenant aux fondements même du langage cinématographique. Cette tendance est surtout illustrée par des noms comme Philippe Garrel, avec Marie pour mémoire (1967), Le Révélateur (1968), Le Lit de la vierge (1969), Les Hautes Solitudes (1973), etc, Yvan Lagrange avec Tristan et Iseult (1972) et Jacques Robiolles avec Le Jardin des Hespérides (1975).
Proches de ce courant, on rangera les tentatives cinématographiques d’écrivains comme Alain Robbe-Grillet, avec L’homme qui ment (1968), L’Éden et après (1969) ou Glissements progressifs du plaisir (1973) et surtout Marguerite Duras, qui, avec Détruire, dit-elle (1969), Nathalie Granger (1972), La Femme du Gange (1973) et India Song (1974), amorçait cette exploration des vertiges cinématographiques, qui allait la conduire jusqu’aux limites d’un non-cinéma, revendiqué comme but ultime de sa démarche.
Tout comme celle de Godard, cette démarche allait exercer un pouvoir de fascination sur certains cinéastes apparemment éloignés d’elle, ainsi Eric Rohmer, captivé par la part croissante faite à la parole, dans ce qui cessera bientôt de pouvoir être appelé un art de l’image. Quant à l’inclassable Jean-Daniel Pollet, il oscille d’un cinéma pseudo-commercial (L’amour c’est gai, l’amour c’est triste, 1968) à une sorte d’avant-garde, très personnelle, avec Le Maître du temps (1969) ou Aquarius (1971).
LES HAUTES SOLITUDES de Philippe Garrel, sorti en France (1974) avec Jean Seberg, Nico, Tina Aumont, Laurent Terzieff
L’HOMME QUI MENT de Alain Robbe-Grillet (1968) avec Jean-Louis Trintignant
L’AMOUR C’EST GAI, L’AMOUR C’EST TRISTE de Jean-Daniel Pollet (réalisé en 1968, sorti en 1971) avec Claude Melki, Bernadette Lafont, Jean-Pierre Marielle, Chantal Goya, Marcel Dalio
De quoi rire et frémir
A l’opposé de ces recherches ésotériques, souvent ignorées du public (c’est l’époque où les films qui ne trouvent pas de distributeur deviennent nombreux), on voit un cinéma pour les masses devenir plus prospère que jamais, en dépit de la crise cinématographique bien réelle. Si Bourvil meurt en 1970 et Fernandel en 1971, c’est à ce moment que Louis de Funès s’installe définitivement dans son personnage de grand comique national, grâce surtout aux films de Gérard Oury ; après La Grande Vadrouille (1966), record absolu du box-office français, ils tournent ensemble La Folie des grandeurs (1971) et Les Aventures de Rabbi Jacob (1973), deux autres grands succès, que vient compléter, pour de Funès, la série du Gendarme, réalisée par Jean Girault (Le gendarme se marie, 1968, etc.).
Un concurrent dangereux semble un moment se manifester, avec Jean Yanne, acteur réalisateur de Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil (1972) et Moi y en a vouloir des sous (1973), dont l’humour souvent savoureux connaît un immense succès. Mais ce ne sera qu’un feu de paille, auquel le demi-échec des Chinois à Paris (1974), et celui, total, de Chobizenesse (1975), viennent pratiquement mettre fin.
Moins corrosif et plus boulevardier, Michel Audiard, fameux scénariste passé à la mise en scène, tourne plusieurs films dont les plus connus sont sans doute Elle boit pas, elle fume pas, elle drague pas… mais elle cause (1970) et Comment réussir dans la vie quand on est con et Pleurnichard (1973). Il réalise également Vive la France ! (1973), film de montage satirique un peu facile et que son esprit anarchiste de droite fit mal accueillir. Sa carrière de réalisateur tournant court, Audiard reviendra à son ancienne spécialité, où l’attendaient de nouvelles satisfactions.
Parmi les cinéastes les plus appréciés du grand public, Henri Verneuil figure au premier rang, avec Gérard Oury. Il tourne alors une série de films policiers à succès, Le Clan des Siciliens (1969), Le Casse (1971), Le Serpent (1972), Peur sur la ville (1975), œuvres adroitement réalisées, avec un tour de main qui se veut « à l’américaine» et y parvient parfois, et bien servies par des interprètes de choix (Gabin, Delon, Ventura, Belmondo). Dans un genre assez voisin, mais avec une réussite moins constante, opère ainsi l’ancien romancier José Giovanni : La Scoumoune (1972), Deux Hommes dans la ville (1973), Le Gitan (1975). Les acteurs sont souvent les mêmes que chez Verneuil, car, aux yeux des producteurs, les recettes de succès ne sont pas variées… C’est ce qu’on peut vérifier avec les films d’un autre cinéaste à la mode, d’ailleurs de bonne qualité : Jacques Deray qui, après La Piscine (1968), obtient un triomphe en réunissant Delon et Belmondo dans Borsalino (1970), qui sera suivi de Borsalino and Co (1974) – sans Belmondo – et de Flic Story (1975) avec Delon et Trintignant.
Toujours dans le genre policier, mais avec l’ambition déclarée de faire du « cinéma d’auteur » Jean-Pierre Melville cultive son style très personnel, non dénué de maniérisme, dans Le Cercle rouge (1970) et Un flic (1972) avant de disparaître prématurément en 1973. Enfin, avec Max et les ferrailleurs (1971), c’est une belle réussite relevant du policier que signe Claude Sautet ; pourtant, ses plus grands succès publics, il les obtiendra dans une autre veine, celle du romanesque et de l’observation des mœurs, qu’illustrent Les Choses de la vie (1970), César et Rosalie (1972) ou Vincent, François, Paul et les autres (1974).
Autre habitué du box-office, Claude Lelouch a au moins le mérite de n’exploiter systématiquement ni les recettes du comique facile, ni celles du policier classique, même s’il recourt à l’occasion à l’un ou l’autre de ces genres. Il tourne beaucoup au cours de la période, souvent avec succès, et pas seulement sur le plan commercial : Un homme qui me plaît (1969), Le Voyou (1970), L’aventure, c’est l’aventure (1972), La Bonne Année (1973). Par contre, un film plus ambitieux, Toute une vie (1974), qui se présente comme une grande fresque d’histoire contemporaine, essuiera un échec sans appel. Le cinéaste s’en remettra en alignant quatre nouveaux films coup sur coup, afin de confondre ses détracteurs.
LES AVENTURES DE RABBI JACOB de Gérard Oury (1973) avec Louis de Funès, Claude Giraud, Suzy Delair, Renzo Montagnani, Henri Guybet
TOUT LE MONDE IL EST BEAU, TOUT LE MONDE IL EST GENTIL de Jean Yanne (1972) avec Jean Yanne, Michel Serrault, Bernard Blier
ELLE BOIT PAS, ELLE FUME PAS, ELLE DRAGUE PAS, MAIS… ELLE CAUSE ! de Michel Audiard (1970) avec Annie Girardot, Bernard Blier, Mireille Darc
LE CASSE d’Henri Verneuil, (1971) avec Jean-Paul Belmondo,Omar Sharif
LES CHOSES DE LA VIE Claude Sautet (1970) avec Michel Piccoli, Romy Schneider, Lea Massari
LA BONNE ANNEE de Claude Lelouch (1973) avec Lino Ventura, Françoise Fabian, Charles Gérard
Anciens de la nouvelle vague et vétérans du cinéma
En 1968, la nouvelle vague a dix ans (Le Beau Serge ou Les Mistons sont de 1958), et ses cinéastes sont en pleine maturité. A part Godard et un peu Malle, ils n’ont guère, dans l’ensemble, réagi aux événements de Mai. Cette année-là, Truffaut a montré Baisers volés, où il poursuivait l’histoire d’Antoine Doinel, son premier héros, aux accents nostalgiques d’une vieille chanson de Charles Trenet, avant d’y revenir en 1970 avec Domicile conjugal. Difficile d’être plus inactuel… Entretemps, il a réalisé un policier, tout à fait manqué, La Sirène du Mississippi (1968) et un film psychologique en costumes, excellent, L’Enfant sauvage (1969). Parmi ses autres films, Les Deux Anglaises et le continent (1971), histoire discrète qui contient de jolis moments, La Nuit américaine (1972), peinture du milieu cinématographique, L’Histoire d’Adèle H (1975), biographie émouvante de la fille de Victor Hugo.
Tout aussi étranger aux remous de l’époque demeure Eric Rohmer, qui poursuit avec impavidité sa série de Six Contes moraux, avec Ma nuit chez Maud (1969), fascinante méditation pascalienne, Le Genou de Claire (1970) fable douce-amère digne du siècle passé, et L’Amour l’après-midi (1972), un peu plus contemporain en apparence, mais ce n’est qu’une apparence. Finalement, Rohmer est encore bien plus inactuel que Truffaut, cette ignorance têtue de la mode faisant d’ailleurs partie de ses principaux mérites. Alain Resnais avait fait une incursion dans le cinéma politique dès 1966, avec La Guerre est finie, consacré aux séquelles de la guerre d’Espagne; en 1968 il se réfugia dans l’imaginaire, avec Je t’aime, je t’aime, avant de succomber, à sa manière, à la « mode » rétro avec Stavisky (1974). Quant à Jacques Demy qui en 1968 tournait Model Shop (The Model Shop) en Amérique, de retour en France il choisit la féerie, adapte Perrault et se met à conter Peau d’Ane (1970), non sans charme d’ailleurs, avant d’aller continuer avec Grimm en Angleterre (Le Joueur de flûte (The Pied Piper of Hamelin), 1972). D’autres enfin optent pour l’histoire, tel Jean-Paul Rappeneau, avec ses agréables Mariés de l’an II (1971).
Les cinéastes des générations antérieures apparaissent tout aussi désaccordés par rapport à l’actualité. Jean Renoir se voit refuser une avance sur recettes du ministère de la Culture pour un projet intitulé avec à-propos C’est la Révolution ! Il pourra en utiliser quelques éléments dans ce qui sera son dernier film, Le Petit Théâtre de Jean Renoir (1969), produit grâce aux télévisions française et italienne, avant de se retirer aux Etats-Unis.
Guère plus chanceux, Clouzot, malade, vieilli, ne pourra rien faire après La Prisonnière (1968) où apparaissent les préoccupations métaphysiques qui hanteront ses dernières années. C’est également la métaphysique qui inspire, plus ouvertement, l’œuvre de Bresson ; celui-ci adapte deux fois Dostoïevski, dans Une femme douce (1968) et Quatre Nuits d’un rêveur (1971), avant de réaliser son admirable poème médiéval, Lancelot du lac (1974), projet poursuivi pendant vingt ans avant d’être enfin mené à bien.
L’autre grand solitaire du cinéma français, Jacques Tati, ruiné par l’échec de Playtime (1968), peut-être son chef-d’œuvre, parvient dans des conditions difficiles à tourner Trafic (1971) puis Parade (1974), avant de retomber dans un silence définitif et plein d’amertume. Condamnés au silence, également, Autant-Lara, après l’échec des Patates (1968), Gance qui récrit inlassablement un Christophe Colomb qu’il ne tournera jamais, Astruc qui ne pourra pas davantage monter son adaptation des « Affinités électives » de Goethe, et d’autres encore.
Plus heureux, Buñuel, qui tourne aussi en Espagne (Tristana, en 1970), parviendra à poursuivre en France une œuvre pour le moins inégale : La Voie lactée (1969), Le Charme discret de la bourgeoisie (1972) et Le Fantôme de la liberté (1974). D’autres exilés, polonais comme Borowczyk (Goto, l’île d’amour, 1969 ; Blanche, 1971) ou belges comme André Delvaux (Rendez-vous à Bray, 1971) viennent infuser un sang neuf au cinéma français.
L’HISTOIRE D’ADELE H.de François Truffaut (1975) avec Isabelle Adjani, Bruce Robinson
PEAU D’ÂNE de Jacques Demy (1970), inspiré du conte de Charles Perrault paru en 1694 avec Catherine Deneuve, Delphine Seyrig, Jacques Perrin, Jean Marais, Micheline Presle
LA PRISONNIERE est un film français réalisé par Henri-Georges Clouzot sorti en 1968 avec Laurent Terzieff, Elisabeth Wiener, Bernard Fresson, Dany Carrel, Claude Piéplu
TRAFIC de Jacques Tati (1971) avec Jacques Tati, Maria Kimberly
LE CHARME DISCRET DE LA BOURGEOISIE de Luis Buñuel (1972) avec Fernando Rey, Paul Frankeur, Delphine Seyrig, Stéphane Audran, Bulle Ogier, Jean-Pierre Cassel
La relève
C’est l’époque où un apport national nouveau réussit également à se manifester avec plus ou moins de bonheur. La nouvelle vague intégrée dans le système dans son ensemble, il y a place pour de nouveaux venus. Beaucoup, grâce aux avances sur recettes, parviennent à tourner un premier film. La difficulté, c’est de continuer. Une dizaine de nouveaux cinéastes, pas davantage, imposeront un talent véritable, sans faire trop de concessions.
Ancien acteur de Truffaut et Chabrol et grand admirateur de Bresson, Gérard Blain fait d’intéressants débuts avec Les Amis (1970), que suivront Le Pélican (1973) et Un enfant dans la foule (1975), encore supérieurs. Déjà auteur des Ruses du diable (1965) et ancien critique aux Cahiers du Cinéma, Paul Vecchiali affirme avec L’Étrangleur (1970) et Femmes, femmes (1974) un style très personnel qui s’épanouira dans son œuvre ultérieure.
Pascal Thomas, également ancien journaliste, se révèle comme un des débutants le plus prometteurs, avec Les Zozos (1972) et Pleure pas la bouche Pleine (1973) ; après un ou deux films moins réussis, lui aussi fera mieux par la suite. Avec L’Enfance nue (1969) apparaît Maurice Pialat, très prisé des cinéphiles, mais ignoré du grand public ; il rencontrera le succès avec un film moins confidentiel, qu’il désavouera en partie, Nous ne vieillirons pas ensemble (1972), avant de réaliser La Gueule ouverte (1973), œuvre très noire qui sera vue par très peu de spectateurs. Pialat restera ensuite de longues années sans pouvoir tourner de nouveau film. Plus dramatique encore sera le sort de Jean Eustache qui, après la révélation tumultueuse de La Maman et la putain (1973), et un film à demi réussi, Mes petites amoureuses (1975), se verra réduit à une situation marginale, dont il s’échappera par le suicide.
A l’écart des modes, René Allio poursuit une intéressante carrière avec Pierre et Paul (1969), et surtout Les Camisards (1970), film historique plus soucieux de vérité intérieure que de reconstitution spectaculaire, et qui annonce cet authentique chef-d’ œuvre méconnu que sera Moi, Pierre Rivière... (1976). Parmi les bons films ignorés de la période, il faut encore citer La Traque (1975) de Serge Leroy, habile spécialiste du film d’action, qui, grâce à un sujet exceptionnel, montrait à quel niveau il est susceptible de se hausser.
Après une longue carrière de scénariste, Jean-Charles Tacchella débute dans la mise en scène en 1973 avec Voyage en Grande Tartarie, mais c’est avec l’amusant Cousin cousine (1974) qu’il remportera un triomphe démesuré, y compris aux Etats-Unis, pays traditionnellement allergique au cinéma français.
Tous ces exemples montrent l’importance du scénario, parent pauvre de la nouvelle vague, dans les réussites du nouveau cinéma français. On peut en dire autant des films de Bertrand Blier ou Bertrand Tavernier, autres nouveaux venus pleins de talent. Le premier, après deux films modestes, s’impose avec le coup d’éclat des Valseuses (1974), suivi de Calmos (1975), moins bien accueilli, mais plus original. Quant au second, cinéphile et ancien critique, c’est significativement qu’il s’adresse à Aurenche et Bost pour le scénario de son premier grand film, L’Horloger de Saint-Paul (1974), qui d’emblée lui vaut le prix Delluc. Succès confirmé par Que la fête commence (1975), film historique plus inégal, mais plein des qualités que Tavernier allait développer dans les films suivants.
Toutefois, aucun de ces cinéastes n’égalera dans la faveur du public Emmanuelle (1973) du photographe Just Jaeckin, Le triomphe inespéré de ce film érotique (8 millions de spectateurs en France, à ce jour), entraînera le déferlement de la vague pornographique, avec ses Jouisseuses (1975), ses Exhibition (1975) et ses Furies porno (1975), qui, en quelques mois, submergèrent le marché français (plus de 15 % de la fréquentation). Les films normaux furent noyés au milieu des titres (épicés) de ces bandes tournées en quatre ou cinq jours, qui déshonoraient les façades des Champs-Élysées. Il fallut une loi, celle du 31 octobre 1975, pour y mettre bon ordre. Puis la mode reflua. D’autres périls guettaient un cinéma français tombé à 175 millions de spectateurs en 1973, contre 300 millions dix ans plus tôt… Derrière une façade assez brillante pour faire illusion, la crise était sérieusement installée.
LE PELICAN de Gérard Blain (1974) avec Gérard Blain, Dominique Ravix, Daniel Sarky
NOUS NE VIEILLIRONS PAS ENSEMBLE de Maurice Pialat (1972) avec Marlène Jobert, Jean Yanne, Macha Méril, Christine Fabrega
LA MAMAN ET LA PUTAIN de Jean Eustache réalisé (1973) avec Jean-Pierre Léaud, Françoise Lebrun, Bernadette Lafont
QUE LA FÊTE COMMENCE de Bertrand Tavernier (1975) avec Philippe Noiret, Jean Rochefort, Jean-Pierre Marielle, Marina Vlady, Christine Pascal
Le Midi Minuit , sur les Grands Boulevards en 1972 (Boulevard Poissonière, Paris) © Michel Giniès
Le cinéma des années “Pompidou” A l'instar des institutions et des mentalités, le cinéma français n'a pas échappé à l'influence de Mai 68.
#bertrand tavernier#claude chabrol#claude sautet#costa gavras#françois truffaut#henri georges clouzot#jacques demy#jacques tati#jean eustache#jean luc godard#jean pierre melville#louis malle#luis bunuel#michel audiard
0 notes
Text
Soutien à André Paccou et à la LDH Corsica. Nous sommes déjà 254 personnes à avoir décidé, en conscience, de rejoindre la démarche proposée par cette déclaration.

Soutien à André Paccou et à la LDH Corsica la déclaration:
http://terrecorse.tumblr.com/post/154973384885/soutien-%C3%A0-andr%C3%A9-paccou-et-%C3%A0-la-ldh-corsica
Nous approuvons cette déclaration
La campagne de haine et les appels à la violence, qui se développent sur internet contre le premier responsable de la Ligue des Droits de l’Homme en Corse, sont contraires aux simples droits humains, ils sont inacceptables et dangereux pour notre société. Nous appelons les démocrates, quelles que soient leurs convictions politiques personnelles, à soutenir cette déclaration en faveur de la Ligue des Droits de l’Homme : elle a déjà eu pour effet d’entraîner la réaction haineuse, sur internet, d’un groupuscule fascisant ; preuve, s’il en fallait une, que ce texte vise juste. Nous décidons, même si nous ne partageons pas toutes les options des initiateurs de cette déclaration, d’apporter sur ce point notre soutien à leur démarche.
Les 254 premiers signataires (au 15 janvier 2017)
Jean-Claude Acquaviva ; Jean-Charles Adami, Joseph Agostini ; Rudhy Albertini ; Jean Alesandri ; Juliette Alesandri ; Fanfan Alesandri ; Nicolas Alaris ; Isaline Amalric ; Charly Amet ; Jean Louis Amidei ; Madeleine Amidei ; René Amoretti ; Anissa-Flore Amziane ; Sylvie Andula-Mouton ; Angelici-Derosa Marie-Ange ; Patrice Antona ; Ghjuvan Maria Arrighi ; Florence Antomarchi ; Philippe Arnauld ; Jacqueline Arrii-Wroblevski, résistante, présidente d’une association d’Anciens Combattants ; Audouard Gaetan ; Etienne Bastelica ; Alain Barinet ; François Bartoli ; Jean-Pierre Battestini ; Lina-Joss Beautier ; Alain Benielli ; François Berlinghi ; Viviane Biancarelli ; Joachim Bigi ; Jean-Michel Biondi ; Renée Bisgambiglia ; Jean-Paul Blandino ; Sophie Blervaque-Baudouin ; Nicolas Blin ; André Borchini ; Marc Borelli ; Paul Borelli ; Henri Brosse ; Paula Bruschini ; Jean-Baptiste Bruschini ; Dominique Bucchini ; Muriel Buisson ; Alain Calisti ; Alexandra Landro Cancellieri ; Anthony Casanova ; Patrice Casanova ; Charles Casabianca ; Paul Casabianca ; Marie Casabianca ; Agnès Casale ; Amiel Casale ; Leonisa Casale ; Noël Casale ; Charles Cassetari ; Valérie Caux ; Françoise Ceccaldi-Nordee ; Daniel Cerutti ; Ange Cesari ; Laurent Chiocca ; Michèle Chiocca ; Katia Chipolina ; Hyacinthe Choury ; Marcelle Cimino ; Antoine Ciosi ; Corinne Clavière ; Jacky Corbel ; Philippe Coutellier ; Antoine Crestani ; Patricia Curcio ; Stéphane Cuvilliez ; Michel D’Alverny ; Paulette Dadoit-Ristorcelli ; Marc Defendini ; Pierre-Jean Delavalle ; Serge Demailly ; Francine Demichel ; Toussainte Devoti ; Diego Diaz ; Patricia Dieudonné ; Jean-Charles Dionisi ; Franck Domain ; Guy Doussot ; Nicole Duplan ; Françoise Dumahu ; Gérard Elineau ; Antonia Erhart ; Antoine Etienne ; Jean-Pierre Fabiani ; Antoine Fanucci ; Pierre Faure ; Marie-Odile Favard ; Michel Fazzini ; Manette Ferrandini ; Jean-François Ferrandini ; Ange-Marie Filippi-Codaccioni ; Paulette Filippi-Codaccioni ; Claudine Filippi ; Ange-François Filippi ; Béatrice Fillios ; Marie-Pierre Fiori ; Juliette Fix ; Michel Fix ; Martine Fort ; José FORT ; France Insoumise (Marseille) ; Félix Franceschi ; Mélanie Franceschi ; Michèle Furtuna ; Gérard Gagliardi ; Alexandra Gaffory ; Raymond Gas ; André Gaudemard ; Ignazio Genova ; Marcel Giard ; Philippe Istria ; Hélène Giacomoni, Jean Jacques Gil, Jean-Michel Gilbert ; Serge Gori, Alex Gonzalez, Chantal Gossin, Paquy Graziani, Dominique Guglielmacci, Christian Guadagnini, Jeanne Guerra ; Pierre Guidicelli ; Michel Houdayer ; Daniel Herrmann ; Claudine Jouet-Maginot ; Benoît Laforêt ; Martine Lefuma-Maginot ; Gilles Larnaud ; Paul Larnaud ; Françoise Larouge ; Serge Laybros ; Maïté Lemire ; Stéphane Leroy ; Charly Levenard ; Catherine L’helgouach ; Jacqueline Lledo ; Yves Lledo ; Pierre Llorens ; Jean-François Lomellini ; Jean-Pierre Lovichi ; Catherine Lovighi ; Anne-Marie Luciani ; Marc Luciani ; Jean-Pierre Luciani ; Marie-Josée Luciani ; Paul Antoine Luciani ; Viviane Lucchini ; Ghjiseppu Maestracci, collectif Ava Basta ; Jean-Pierre Maginot ; Chloé Maginot ; Danièle Maoudj ; Antoine Mandrichi ; Joseph Marcaggi ; Francis Marcantei ; Françoise Mariani ; Charles Mariani ; Thérèse Marietti ; Yves Marietti ; Pierre Mariini ; Liliane Mariini ; Béatrice Martin ; Marie-Antoinette Massimi ; Marius Massimi ; Jean-Marie Mattei ; Patrick Maurieres ; Jean-Michel Medori ; Angèle Mercuri ; Guy Meria ; Nicole Mesquida ; Leo Micheli ; Jeanine Mondoloni ; Bruno Mondoloni ; Gérard Mondoloni ; Marie-Ange Moracchini ; Fanfan Moracchini ; Baptiste Murroni ; Christophe Muselli ; Pierre-Ange Muselli ; Marie-Jeanne Nicoli ; Maxime Nordee ; Marie-France Nunez ; Occitania Antifascista ; Roland Orève ; Pascale Ortoli ; Tony Paoli ; Marie-Françoise Paoli ; Cathy Paolini ; Antoine Paolini ; Marie-Angèle Paolini ; Alain Peraldi ; Françoise Perbet-Savelli ; Jacques Perona ; Roland Perona ; Marie-Lucie Perona ; Annick Peigné-Giuly ; Natacha Pimenoff ; Noël Pinzuti ; Marine Play ; Daniel Play ; Marthe Poli ; Eve Pommepuy ; Nadine Poulain ; Jacqueline Prévert ; Jean-Marc Pupponi ; Anita Marie Rao ; Jean Rabaté ; Marlène Rasori ; Lou Rengue ; Monique Richoux ; Christophe Richoux ; Josette Risterucci ; Nadine Ristorcelli-Domain ; Mickael Romani ; Marcelle Rombaldi ; Fred Roquelle ; Pascal Rossi ; Philippe Sabot ; Julia Sanguinetti ; Sampiero Sanguinetti ; Michèle Santamaria ; Cindy Santacroce ; Jean-Pierre Savelli ; Lila Adelina Segal ; Marie Sereni ; Danael Serre ; Santa Simonpietri ; Catherine Soro ; Sophie Soubeyrand ; Michel Stefani ; Gilbert Stromboni ; Liza Terrazzoni ; Jean-Jacques Thomas ; Christiane Tomei ; Ange Tomei ; Louis Tomei ; Dominique Torre ; Rosette Tramoni ; Michel Tramoni ; Stéphanie Tramoni ; Jean Valéry ; Guy Vianey ; Noelle Vincensini, ancienne déportée, résistante ; Didier Wallisch-Santoni ; Louis Zedda ; Yolande Zicchina ; Noël Zicchina ; Patrick Zucconi.
Nous sommes déjà 254 à avoir décidé, en conscience, de rejoindre la démarche proposée par cette déclaration. C’est un résultat important qui prouve une volonté de résistance et de rassemblement pour défendre ce que représente une organisation démocratique comme la Ligue des Droits de l’Homme ; et pour faire face aux forces obscures, de plus en plus actives et insidieuses, qui tentent de saper les fondements mêmes du pacte républicain.
Cette volonté de résistance et de rassemblement est loin de n’être que celle des initiateurs communistes d’une déclaration qui est désormais la nôtre. Notre nombre et notre diversité nous donnent de la force, une force qui sera d’autant plus efficace que le nombre de nos soutiens prendra une ampleur inédite dans les jours qui viennent.
Tous ceux qui veulent partager et signer cette déclaration de soutien à la LDH, peuvent le faire en contactant un militant ou en envoyant un message aux adresses suivantes : [email protected] ou bien [email protected] ou encore en écrivant aux blogs « U Rossu » et « Terre corse », ou encore sur le compte Facebook : « PCF-Fédération de la Corse du sud ». Ils peuvent aussi s’adresser directement à la LDH en précisant qu’ils soutiennent notre déclaration.
0 notes
Text
Cabottes d'Or : le cellier du Clos Vougeot a rendu hommage à la chanson bourguignonne
Cabottes d’Or : le cellier du Clos Vougeot a rendu hommage à la chanson bourguignonne

View On WordPress
#Alexandra Bouvret#bourgogne magazine#Cabottes d&039;Or#Cadets de Bourgogne#Caroline Drouhin#Chanson à boire#Chanson bourguignonne#domaine Françoise André#Domaine Marc Roy#Fred Bernard#Jean-Bernard Guiboux#Louis Bouillot#Michel Faget#Michel Grobon#Mickaël Azouz#patrick bertron#Philippe Charlopin#Philippe Delin#Relais Bernard Loiseau#Stéphane Derbord#Takashi Kinoshita
0 notes
Text
Michel André n’est plus, la Bourgogne perd l’un de ses grands serviteurs
Michel André n’est plus, la Bourgogne perd l’un de ses grands serviteurs
Après un long combat mené avec courage et dignité face à la maladie, Michel André s’en est allé en écoutant la musique de Maurice André. La Bourgogne dit adieu à l’un de ses grands serviteurs, aussi discret que bienveillant, infatigable militant de son territoire et de l’esprit d’entreprise.

Michel André, ici avec son épouse Françoise au sein du domaine portant son nom. © D.R.
Certains…
View On WordPress
0 notes