Text
"Le cerveau peut faire des merveilles lorsqu'il est apaisé."
Jonathan CURIEL
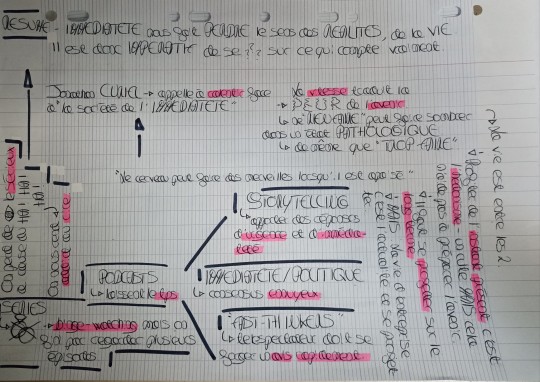
0 notes
Text
Compte-rendu, Ce que sait la main, Richard Sennett.
Paragraphe 1:
Il s'agit d'un essai visant à réhabiliter le travail artisanal. En effet, le clivage historique entre la théorie et la pratique, l'artiste et l'artisan et le travail intellectuel et technique fait souffrir la société moderne. La revalorisation du travail artisanal est alors perçue comme un moyen de remédier à ce problème. Richard Sennett propose alors une analyse approfondie du travail artisanal avec la mise à jour de ses vertus. Il s'agit d'un propos philosophique et général offrant une définition extensive du métier et de l'artisanat (craft et craftmanship). L'artisanat est présenté comme un modèle pour la société.
Paragraphe 2:
Richard Sennett annonce une rupture avec Hannah Arendt puisqu'il remet en question la distinction entre Homo faber et Animal laborans. Selon Hannah Arendt, l'Animal laborans serait absorbé par sa tâche ce qui serait amoral tandis que l'Homo faber serait capable de juger de façon éthique son travail. Richard Sennett oppose donc à cette théorie celle que l'Animal laborans devrait faire preuve d'intelligence car la pratique d'un métier nécessite autant la tête que la main. Il s'inscrit dans la tradition du pragmatisme américain puisqu'il fait une éloge de la culture matérielle c'est-à-dire du travail technique en expliquant précisément ce que fait l'artisan lorsqu'il travaille. Cette perspective d'analyse peut-être rapprochée de celle de Matthew B. Crawford qui décrit sa reconversion professionnelle en se prenant lui-même comme objet d'étude en insistant sur la dégradation du travail de la "creative class" sous l'effet de la séparation entre la planification et l'exécution. Cela traduit une grande insatisfaction due au capitalisme moderne.
Paragraphe 3:
Il développe une analyse de différents métiers artisanaux, s'intéresse à différents domaines d'application et emprunte de multiples références théoriques. L'érudition et la transdisciplinarité qui sont associées à un style d'écriture peu académique rendent la lecture du livre particulièrement vivifiante et stimulante.
Paragraphe 4:
Il s'agit du plan d'étude du compte-rendu de l'ouvrage : 1 "Quand faire", c'est penser, 2 "La routine au centre de la création", 3 "L'artisanat comme modèle".
Paragraphe 5:
Quand faire, c'est penser : La supériorité de la théorie sur la pratique et la dévalorisation consécutive de la technique dans la civilisation occidentale actuelle s'expliquerait, selon l'auteur, par le fait que les idées sont plus durables que les matériaux. Cependant, la mise en forme des matériaux ne peut pas se départir des idées car la conception est indissociable de l'exécution comme la tête l'est de la main. Cette analyse démontre donc l'intelligence de la main. Sous l'effet de son expérience, l'artisan parvient à anticiper les sensations lors de la saisie d'objets ou d'outils et peut ainsi ajuster ses gestes en fonction de cette intuition forgée dans la pratique. Les gestes les plus anodins font ainsi appel à l'esprit en vue afin de fournir un bon travail. L'expérimentation via l'erreur et également caractéristique de l'artisan qui cherche à s'améliorer. L'expérimentation est précisément de faire naître à la conception de l'exécution. Le travail de l'artisan requiert une forme d'intelligence et une capacité à penser dans le faire. Les artisans mettent en œuvre une intelligence pratique, rusée et créative qualifiée de métis. Cette métis traduit un savoir-faire de situation et un art de combiner (capacité d'adaptation essentielle au travail artisanal).
Paragraphe 6:
Richard Sennett propose ensuite une conception positive de la routine. Contrairement à Adam Smith, qui pensait que la routine était abrutissante, Richard Sennett montre que l'acquisition de compétences manuelles spécialisées à travers la répétition des mêmes gestes fait émerger des formes de compréhension mentale. L'artisan peut ainsi anticiper les réactions du matériau à ses propres stimuli. Cette conscience des interactions entre le corps et le matériau et le produit de la routine qui favorise dans le même temps l'intériorisation des gestes du métier. La routine n'est donc pas synonyme d'ennui mais de plaisir dans le travail. Les sciences sociales ont réhabilité la routine en insistant sur ses vertus. La routine favoriserait l'acquisition de compétences mais aussi l'innovation. Elle est donc perçue comme un facteur crucial pour la compréhension du processus de création.
Paragraphe 7:
Il aborde ensuite la question classique de l'opposition entre art et artisanat. Il insiste sur le fait qu'artistes et artisans était autrefois confondus. La figure de l'artiste individualiste aurait émergé à la Renaissance en se distinguant de la communauté des artisans médiévaux. Dans cette optique, il invite à se méfier des prétentions au talons aînés non formés : selon lui l'inspiration ou l'intuition créatives s'inscrivent dans la routine.
Paragraphe 8:
Il explique que l'artisan est capable de créativité au travers de "sauts intuitifs". Ce sont des sauts de l'imagination qui témoignent de la réflexion menée dans le cadre d'un travail technique. Il démontre que l'artisan est doté d'une conscience matérielle, c'est-à-dire une conscience en son aptitude à modifier les choses. Richard Sennett propose ensuite 4 séquences qui composent le "saut intuitif" : 1 Le reformage (l'artisan cherche s'il peut changer l'usage d'un outil ou d'une pratique), 2 L'adjacent (il compare deux domaines dissemblables), 3 La surprise (il découvre qu'une chose diffère de ce qu'il imaginait) et 4 La gravité (il prend conscience du fait que tous les problèmes ne sont pas résolus par son saut imaginatif). Le résultat du saut intuitif est la création qu'elle concerne une solution technique ou une innovation esthétique. À travers les quatre séquences Richard Sennett décrit un raisonnement de type inductif qui serait au fondement de la création. L'intuition se travaille et elle trouve son origine dans la pratique routinière de l'activité technique.
Paragraphe 9:
L'artisanat est présenté par Richard Sennett comme un modèle général d'analyse du travail. Il évoque ensuite, une certaine obsession positive qui pousserait les artisans à s'investir dans la fabrication d'un objet ou dans la formation d'une compétence. Ensuite, Richard Sennett remet en question la place de la conception assistée par ordinateur qui remplace aujourd'hui le dessin à la main dans le travail des architectes. Le dessin manuel permettait à l'architecte de véritablement prendre connaissance de son terrain mais en dissociant la simulation et la réalité et donc la tête de la main la CAO exclut une certaine forme d'intelligence relationnelle et conduit à de nombreuses erreurs et imperfections dans le travail.
Paragraphe 10:
Il propose l'artisanat comme un modèle d'analyse pour les chercheurs en sciences sociales puisqu'il l'érige en modèle politique normatif. Il voit l'artisanat comme un modèle d'organisation sociale du travail à suivre en vue de l'établissement d'une société meilleure. L'artisan est associé à un ensemble de valeurs morales telles que : la modestie et la valorisation des tâches manuelles sur le même plan que les labeurs de l'esprit. La morale n'est donc pas étrangère à la valorisation de l'artisanat comme modèle. Selon Richard Sennett, chaque personne est en capacité de devenir un bon artisan si elle désire bien faire son travail. Pour accomplir ce but, une organisation sociale du travail adapté doit être mise en place. Il est plus important de valoriser la tête plutôt que la main. Il explique ensuite qu'en valorisant le talent plus que la motivation dans le travail cela aboutirait un "travail sans qualité". Richard Sennett insiste sur la valorisation du travail de qualité qu'est le travail artisanal. Il ajoute également une valeur positive à la lenteur puisqu'elle est associée à un travail de réflexion et d'imagination contrairement à l'urgence caractéristique de notre société moderne. La fin de ce paragraphe est plutôt floue car Richard Sennett ne développe pas sa pensée concernant l'aptitude au travail et l'aptitude politique (il n'interroge pas les préceptes de sa propre famille philosophique). Il écrit en conclusion qu'on pourrait dire que le pragmatisme moderne prend pour argent comptant la conviction de Jefferson : le fondement de la citoyenneté et d'apprendre à bien travailler. Cette conclusion l'oppose fondamentalement à Hannah Arendt (elle aurait mérité d'être explicitée). Effectivement, si l'artisan est capable de réflexion dans son travail, dans quelle mesure cette réflexion lui permet-elle de formuler un jugement éthique sur l'ensemble de ses actions et celle des autres ?
0 notes
Text
Compte-rendu, Pour une science de l'imaginaire, interview de L. Serafini.
Paragraphe 1:
Le Codex Serafinianus fut publié pour la première fois en 1981 chez Franco Maria Ricci. Cet ouvrage décrit les facettes d'un monde lointain/imaginaire (ex: des échelles végétales, de la faune habitant dans les arcs-en-ciel ou encore des voitures transformables en cercueils). Le Codex porte sur différents thèmes tels que : le jardinage, l'anatomie, la mode, les mathématiques et l'architecture ce qui permet au lecteur d'acquérir un savoir encyclopédique sur cet étrange territoire. Des dessins détaillés sont accompagnés d'annotations incompréhensibles (la langue et l'écriture sont imaginaires).
L'éditeur Rizzoli permet à Luigi Serafini de rompre avec les codes de l'ésotérisme pour une esthétique plus classique et transparente.
Paragraphe 2:
Le Codex s'écoule au fil du temps ; un processus naturel ; le besoin constant d'écrire.
Il mélange le dessin et l'écriture ; l'alphabet ne correspond pas toujours à "notre dessin" puisque nous avons tous une écriture/graphie imaginaire. La graphie de Serafini est un mélange de boucles, de circonvolutions, une recherche de plaisir dans le geste/le mimétisme de courbes, d'angles, de mouvements. Les dessins ressemblent parfois à l'écriture et inversement (ils se mêlent). Serafini traduit son rêve d'une écriture cachée. On remarque également des similitudes avec des écritures déjà existantes : le grec, le cinghalais et le grégorien.
Paragraphe 3:
Une écriture hybride qui fonctionne avec des collages, des associations d'idées et de formes (inspirée des Métamorphoses d'Ovide). Le changement, la transformation sont la clé pour comprendre la réalité puisqu'elle est en mouvement en permanence. Nous devons observer notre propre métamorphose. Le Codex après quarante ans d'existence continue à créer des rêveries. Il détourne la tradition des ouvrages scientifiques, encyclopédiques et des planches naturalistes. Le monde est inversé, nous avons la vision de l'autre côté du miroir (ex: télévision avec ses images/visages à l'envers). Le monde est inquiétant et porte pourtant une forme de joie. Il est inscrit dans l'étrange, dans la réalité grâce à différents repères. Luigi Serafini crée une atmosphère joyeuse car il peut faire ce qu'il veut, il est libre (ce monde n'étant pas réel). Cependant, les créatures ont les mêmes problèmes que nous (il le compare à un exotisme des siècles passés ou à un lointain inaccessible). Nous croyons également que les autres cultures sont libérées de nombreuses contraintes mais ce n'est pas le cas car la vie est par nature inquiétante. Selon Seraphini, le Codex survivra à la disparition de son créateur car il a grandi de manière indépendante, comme un fils et qu'il n'a pas besoin de marketing. Il s'est fait connaître grâce à un jeune journaliste néerlandais qui est devenu son évangéliste. Et enfin, le Codex est né d'un élan vital, Luigi Serafini sera immortel à travers lui.
0 notes
Text
Compte-rendu, Le design thinking : un état d'esprit pour une révolution silencieuse de C. Fourmond.
Paragraphe 1:
Selon Catherine Fourmond, de nouvelles réponses ayant pour objet l'Humain doivent être trouvées pour répondre aux mutations économiques, technologiques, sociétales, climatiques, etc.
Paragraphe 2:
Le design thinking, selon elle, est une démarche centrée sur l'utilisateur (empathie). Les solutions trouvées aux problématiques sont désirables, viables (d'un point de vue économique), et fiables (d'un point de vue technique).
Cette démarche offre une ouverture vers l'inconnu avec un résultat incertain basé sur le prototypage pour offrir en fin de compte, une réponse parfaitement ajustée à l'utilisateur.
Paragraphe 3:
Elle considère que le design thinking est une ressource pour les entreprises, qu'il est une aide pour l'organisation et la gestion du changement.
Paragraphe 5:
Rémi Edart considère que le design thinking est une révolution silencieuse et qu'il peut changer le monde.
Paragraphe 6:
La réflexion est centrée sur le besoin de l'utilisateur afin de correspondre au besoin réel et/ou latent. L'enjeu étant de délivrer de la valeur au consommateur.
Il se base sur le prototypage avec la notion d'itération (améliorer le prototype par la répétition)
Paragraphe 7:
Les axes qui guident la pensée de Rémi Edart sont : l'innovation, la transformation et enfin, le fait de faire quelque chose qui a plus de sens sur le plan humain.
Paragraphe 10:
Le design thinking est essentiel dans tous les secteurs.
Paragraphe 12:
Selon Rémi Edart, "Nous avons tous un intérêt économique et de bien commun à être beaucoup plus centré sur l'humain." Le design thinking pourrait profondément changer la société.
Paragraphe 14:
La RSE est faite pour rassurer les parties prenantes. Elle est bien plus qu'une responsabilité sociale ou sociétale.
Paragraphe 15:
Impact social positif lorsque l'Humain est au centre de la démarche.
Paragraphe 17:
Rémi Edart, a une activité de facilitateur et de coach pour accompagner les entreprises dans des projets d'innovation et de transformation. Il est aussi l'initiateur de "l'apprentissage par le faire" avec l'organisation d'ateliers certifiants.
Paragraphe 19:
Catherine Fourmond conclut en expliquant que pour Rémi Edart, le design thinking inspire la gratitude envers le pays qu'est la France puisque le modèle social français encourage l'innovation sociale et permet l'offre de nouvelles réponses.
0 notes
Text
Compte-rendu, Pour une Esthétique de la Pop Culture de M. Letourneux.
Paragraphe 1 :
Les blockbusters sont-ils des créations culturelles ou des objets de consommation. L'opposition qui structurait cette question est devenue obsolète. Cela créer un oubli des enjeux intimes et sociaux de ces plaisirs esthétiques.
Paragraphe 2 :
Selon Jacques Rigaud, "Consommer, c'est consumer, mais cultiver c'est faire naître, c'est travailler." Opposition entre la culture et la consommation n'est plus évidente. Paragraphe 3 :
Les blockbusters, la pop musique et les jeux vidéos forment le cœur de notre culture.
Paragraphe 4 :
Le modèle Moderniste du XIXe siècle est "obsolète". L'opposition entre la haute culture et la culture de masse n'est plus qu'un "fantôme". La frontière entre l'artiste et le marché ou bien l'industrie et la création est désormais infirme.
Paragraphe 5 :
Il évoque le modèle de la légitimité de Boudrieu qui est aujourd'hui mal en point. En effet, de nos jours, tout le monde consomme de la culture de masse (bandes dessinées, séries télévisées…). De fait, la question des valeurs et des hiérarchies de goûts apparaît plus plastique puisqu'elles varient selon les contextes sociaux.
Paragraphe 6 :
Selon lui, l'appareil idéologique qui servait de fondement aux discours sur la culture au XXe siècle se défait.
Paragraphe 7 :
Letourneux nous explique que la montée en puissance d'une culture de consommation, l'esthétisation des marchandises, la multiplication des sollicitations médiatiques, l'accélération des rythmes attentionnels ou bien l'hédonisme culturel sont une explication à cette série de mutations.
1 note
·
View note
Text
Compte-rendu, Plaire et Toucher de G. Lipovetsky.
Paragraphe 1 :
Gilles Lipovetsky étudie depuis une trentaine d'année l'évolution des mentalités, des pratiques et des mœurs. Il est attaché à restituer la signification de ces phénomènes sociaux. Ces travaux portent sur l'hyper-individualisme. Dans l'ouvrage Plaire et Toucher,il pose un regard bienveillant sur la postmodernité tendue vers la consommation et le "toujours plus". Il ne choisit pas de parler de postures catastrophistes qui considèrent le consumérisme débridé comme un abrutissement culturel.
Paragraphe 2 :
La postmodernité est caractérisée par un soucis de séduire. Les rituels de séduction ont toujours existé mais sont limités par des obligations collectives - ce qui permet une interprétation libre. Racine est à l'origine du "Plaire et Toucher" qui se développe avec l'individualisme. Mais aujourd'hui, il n'est plus seulement une règle de représentation, il constitue une exigence permanente de fabrication de désir (s) qui remplace cadres et règles traditionnels.
Paragraphe 3 :
Son approche n'est pas seulement descriptive. Elle n'est pas non plus pour la vision apocalyptique de la séduction. Elle est personnelle puisque les consommateurs garde un esprit critique.
Paragraphe 4 :
Un malaise se créer face à l'hyperindividualisme mais cela ne signifie pas forcément qu'il s'agit d'une sociabilité superficielle. Lipovetsky n'est pas moraliste en dépit du désarroi que cause la société de séduction. La profondeur des liens peut exister avec l'individualisme.
Paragraphe 5 :
Ceux qui luttent contre cette logique afin de créer une société plus humaine échouent car la séduction règne en maître.
2 notes
·
View notes