Photo

LA GUERRE INVISIBLE
LE THEATRE ET SON DOUBLE d’Antonin Artaud (1938)
Mise en scène de Gwenaell Morin
10-29 Mars à @lesamandiers
On peut être sûr que la pandémie mondiale actuelle n’aurait pas fait peur à Artaud. Prophète,il avait filé la métaphore de la contagion d’un Mal comme possible force spirituelle assez puissante pour ébranler les strates de la société; s’appuyant sur « la plus merveilleuse explosion de peste », celle de 1720 à Marseille, et son virus, pour expliciter sa théorie du théâtre. Il aurait peut-être accueilli cette terreur comme l’occasion de faire sauter l’esprit moutonneux et plat qui l’« emmerdait tout le temps » des hommes car « sous l’action du fléau, les cadres de la société se liquéfient. L’ordre tombe. Il assiste à toutes les déroutes de la morale, à toutes les débâcles de la psychologie, (…) ». Voilà la fonction du théâtre selon Antonin Artaud.
Ce sont ces effets dévastateurs dans les esprits qu’il doit produire sur le spectateur. Artaud écrit - il n’arrivera jamais vraiment à le mettre en pratique - ce que Morin nomme un « programme » à la trame poétique bouleversante avec la maladie comme métaphore, quarante ans avant Susan Sontag. Un texte unique, isolé, qui n’appartient à aucun courant, aucune avant-garde mais dont tout la monde du théâtre va un jour où l’autre se réclamer ou y faire référence. Pourquoi isolé ? D’abord sa forme, le style hyperbolique et infernal lui confère une poétique de la pulvérisation avec l’anéantissement de tout le théâtre de son époque comme objectif. Il n’est pas celui qu’on attend d’une ambition ouvertement théorique, c’est la forme de l’essai polémique qui est privilégiée. Cet exemplum de littérature apocalyptique soutient paradoxalement qu’il faut abolir le texte et la psychologie des plateaux de théâtre pour qu’il renaisse, l’homme avec. Comme tous les réformateurs du théâtre Stanislavski, Meyerhold et Brecht, c’est l’homme qui doit être changé par les moyens du théâtre. Un long poème contre le texte, contradictoire et révolutionnaire.
C’est surtout par le truchement de sa découverte du théâtre balinais lors de l’Exposition Universelle de 1937 à Paris et son voyage au Mexique que la théorie d’Artaud prend un contour prophétique et délirant.
Le deuxième grand choc que provoque ce texte, amené par ces découvertes d’arts non-occidentaux, c’est l’idée de retour à l’origine du théâtre, un ante-théâtre, c’est-à-dire son ensauvagement, un théâtre avant le théâtre où les signes remplacent les mots et les idées laissent la place aux corps. L’acteur devenant un « athlète du coeur ». Car , selon « le petit-bourgeois de Marseille » comme il l’écrit dans ses Cahiers de Rodez, la société dans laquelle nous vivons a oublié l‘aspect sacré du théâtre qui est un rite où l’on expurge tout le Mal de manière cathartique. Elle a oublié son pouvoir thaumaturge face à une société hagarde et malade.
C’est cette dimension qui intéresse Artaud qui va alors attaquer toute la littérature dramatique. Les répercussions seront intellectuellement énormes, on l’ a dit plus haut.
Que fait Gwenael Morin de ce texte par endroit indéchiffrable, hiéroglyphique ? Dans ce vaisseau de pestiféré ? Monter un texte si violemment anti-théâtral et qui n’ est pas du théâtre. Un texte fait de visions, de fulgurances oscillant entre lucidité et délire, sans nuances.
On connait l’obsession du metteur en scène pour déterrer les classiques ( Molière, Sophocle, Eschyle,..) de leur stupeur -cela, Artaud aurait aimé- et autres grands metteurs en scène ( Vitez, Fassbinder) , sa boulimie de plateau, de concret, de jeu d’acteur avec son Théâtre Permanent aux Laboratoires d’Aubervilliers. Il y a peu d’accointances entre le travail brut et artisanal à la fois de Morin et l’outrance, le refus systémique et permanent des conventions du plus célèbre patient de l’hôpital psychiatrique de Rodez. Pourtant, l’amour archéologique du théâtre de Morin devait le porter vers cet autre obsessionnel même s’il ne se réclame pas du tout de cette esthétique. Comme la plupart des gens de théâtre, la lecture de ce texte a marqué sa jeunesse. Mais c’est le Morin de la maturité qui le met en espace comme s’il fallait un temps long de gestation ou alors un retour aux origines (tiens ? ) de ce qui nous a transporté, soutenu plus jeune dans nos désirs les plus fous. C’est sans doute cette dernière hypothèse qui anime Morin pour ce spectacle. En exergue, le metteur en scène explique être tombé sur une édition trainant dans un théâtre, l’avoir feuilleté et s’être totalement retrouvé dans les idées du Théâtre et son double.
Seulement, mettre des idées sur un plateau c’est-à-dire concrétiser l’abstrait, qui plus est celles d’Artaud pour le théâtre, est à haut risque. La perdition est presque inévitable tant l’ambition est démentielle, tant le désir d’absolu de l’auteur se mêle dans son abord d’un art matériel et éphémère.
Cet absolu qui le tenaille, lui morsure tout le corps, le fait souffrir, le pousse à ce retour aux sources du théâtre. Pur dans sa théorie, impur dans ses actes, sacré et immoral, religieux et scandaleux.
Cet absolu qui veut atteindre le sacré et Morin dans sa nostalgie qui réactualise son idée du théâtre se rejoignent dans la salle des Amandiers transformée pour l’occasion en nef blanche et éphémère qui nous accueille sans sièges, vide, immense où tout est à inventer, à habiter.
D’emblée, Morin se fait bon élève et place un livre géant avec la couverture d’une vieille édition du Théâtre et son double, debout face à nous, placés de face par des ouvreurs incertains tellement l’atmosphère est performative et insaisissable. On comprend de suite la fragilité, la précarité du théâtre nu, avec seulement des corps, des mots et surtout des tripes.
Le livre-totem installé, entrée des acteurs, cercle, très beau choeur. Cercle, lien, prière, le sacré est convoqué.
Puis c’est le blasphème, les mots de malheur d’Artaud dit par l’acteur Richard Sammut, au centre du cercle , raisonnent dans la nef, tout le mal qui le ronge est exsudé. Ancré au sol, le ton est martial, La langue d’ Artaud est imprécatoire et nous regarde en face , nous dévisage, nous déshabille. Peu de déplacements, la langue qui rugit, vibre des pieds à la tête de l’acteur qui ne faiblit pas.
Le cercle éclate, quitte la scène et se mêle au public, donne la voix au public. Un spectateur lit une notice autobiographique de l’auteur qui rappelle les coups, les traumatismes reçus et alors en cours. Couteaux et séjours en hôpitaux s’entrelacent dans la construction d’une figure mythique du maudit. S’il pioche dans d’autres extraits de textes d’Artaud, c’est pour mieux se recentrer sur le personnage et aussi le mettre à distance lui et son oeuvre qui le submerge totalement. Pour ce fair , une mise en scène d’Artaud lui-même grâce à une perruque et le célèbre Pour en finir avec le jugement de Dieu , ovni radiophonique dit par Manu Laskar, retentit non sans grotesque ce qui brise l’ostentatoire imprécation de départ. On reste dans la métaphore religieuse mais au sens de relier car on est dans le public, on circule, il n’y a plus de scène, il n’y a en jamais eu en fait, il n’y a que des corps, le reste est littérature.
Et puisqu’il n’y a que des corps, il y à l’envers du sacré, du beau c’est-à-dire le scatologique, notre noire profondeur, notre âme si seule et malheureuse baignant dans une merde noire. C’est par ce prisme qu’Artaud voyait l’homme, le visible et il cherchait bien sûr comme tout prophète et martyr, l’invisible. Au nom de cela, il menait une guerre au réel, à l’homme de son temps.
Enfin, le troisième temps du spectacle est celui de la destruction caractérisée par un grand marteau que le metteur en scène impose dans l’espace de jeu. Destruction comme toute la dynamique du livre qui veut construire sur les ruines du théâtre, un art qui rend visible l’invisible et libère nos maux intérieurs par un transe de gestes .
Par Artaud, Morin retrouve le travail kinesthésique de l’acteur qui hurle, pleure, chute , cette « transe de gestes » en quête d’une présence. Et si Morin transformait ce désir de capter l’invisible par les corps d’Artaud en hommage à l’acteur de théâtre , toujours entre création et destruction, entre visible et invisible? Et si chez Morin l’acteur était la figure du sacré ?
M.Méric
3 notes
·
View notes
Link
2 notes
·
View notes
Note
Pourquoi cyborg ? Nelly G, Thomas D.
Nelly ! Thomas! Plaisir de vous lire! Je vous embrasse !
Longue histoire que ce nom. Rapidement, c'est une référence à Donna Haraway et son Cyborg manifesto
Je ne m'étends pas trop je vous laisse découvrir !
Venez a Paris !!!!!!
Gros bisous
2 notes
·
View notes
Photo

Contes Immoraux – Partie 1 : Maison Mère
Ecriture et mise en scène: Phia Ménard et Jean-Luc Beaujault – une performance de la compagnie Non Nova.
SILENCE, L'EUROPE S'EFFONDRE
Phia Ménard prend à bras le corps le problème de l’Europe dans cette première partie des « Contes Immoraux » intitulée « La Maison Mère ». Une performance où la colère sourde face à la débâcle du monde semble être l’énergie qui habite ce personnage mi-sauvage mi-maléfique et surtout très punk qui déambule, soulève, scotche (on y reviendra), place, déplace du carton (on y reviendra aussi) pendant plus d’une heure et demi sur le plateau.
Elle nous empoigne par la « progression » de la performance dont le synopsis est très simple : le personnage tente d’élever une maison en carton. Seulement, cette entreprise réalisée directement devant nous sans aucun artifices, devient une aventure impossible et advient une dramaturgie de la capacité ou non de la performeuse à accomplir cette tâche.
Alors, spectateurs, nous sommes traversés par un arc d’émotions qui oscille entre des doutes initiaux devant ce court projet scénique, le rire face au comique du scotch qui n’adhère pas ou s’arrache, face aux parois tombant après une minutieuse et éprouvante installation de notre constructrice damnée, jusqu’à l’émotion intense ressentie physiquement tellement le théâtre est rempli de sa force constructive. Juste avant l’effondrement.
Car, en peu de temps, notre empathie s’amplifie, le spectacle devient tragique. La structure ploie très facilement sous le poids d’une pluie drue balancée du haut du théâtre. Nous contemplons alors un acharnement vain, une force en désuétude, une vitalité réduite en déchet..
L’effet est parfaitement réussi, après la construction, la destruction rapide, tout redevient poussière.
Que signifie la brutale chute de cette architecture précaire ?
Evidemment, on ne peut s’empêcher de penser, dans un premier temps, a « One Week » de Buster Keaton, même aventure solitaire, silencieuse et absurde. Même chute icarienne de l’édifice. Travail avec la matière comme le burlesque sait si bien en tirer une morale, amorale d’ailleurs.
Mais devant cette absurdité préparée, c’est le mythe de Sisyphe qui nous saute aux yeux. Cette entreprise vaine et répétitive issue de la mythologie dont s’empare Albert Camus pour montrer l’absence de sens dans la vie humaine et la nécessité de se révolter contre le vide de la pensée. Car c’est l’absence de sens ou du moins l’échec de ce dernier que met en scène Phia Ménard, avec la matière. Et c’est ce qui nous émeut le plus.
Rappelons que ces « Contes Immoraux » - ils seront déclinés en triptyque « La Maison Mère » en est le premier volet - sont une commande de la Documenta 14, exposition quinquennale d’art contemporain qui s’est déroulée à l’été 2017 à Kassel en Allemagne et Athènes. Les thèmes proposés étaient « Apprendre d’Athènes » et « Pour un parlement des corps », la performance s’approprie explicitement ces enjeux.
Allégorie d’une construction lente et difficile, de son démembrement abrupt, la performance se transforme en une eschatologie de l’Europe.
Phia Ménard s’attaque au coeur de celle-ci, son creuset symbolique, celui du Parthénon, c’est-à-dire la maison d’Athéna patronne de la Cité où est né le demos, le peuple en politique, première apparition du partage du sensible. Cet héritage auquel se réfère dès le préambule le Traité établissant une constitution européenne (https://www.conseil-constitutionnel.fr/…/referendu…/3tce.pdf) disparaît sous une épaisse fumée. Que cela signifie-t-il ?
Nous sommes-nous coupés de ces valeurs humanistes en face de la question migratoire ?
Faut-il détruire cette configuration actuelle de la politique européenne qui s’effiloche dangereusement ? Voyez Orban en Hongrie, Morawiecki en Pologne.
Ce sont ces questions essentielles pour notre avenir en commun qui apparaissent derrière le carton, montrant toute la fragilité d’une monture qui craque, gondole et finit par tomber. Hagards, sonnés, nous sortons avec ces interrogations rendues inévitables par les temps actuels, auxquelles nous serons bien sommés de répondre. Phia Ménard nous le rappelle, il y a urgence.
Mathieu Méric
2 notes
·
View notes
Photo


"hélas"
texte Nicole Genovese
mise en scène Claude Vanessa
Avec André Antébi, Sébastien Chassagne, Nicole Genovese, Nathalie Pagnac, Bruno Roubicek, Adrienne Winling.
Crédit photos : @charlotte fabre
Théâtre de la Tempête du 10 janvier au 9 février 2020
« hélas » est dada, résolument. Il l’est car tout repose sur l’irruption du bizarre dans un quotidien mécanique bien huilé au rituel moderne du repas en famille devant la télévision, centre du dispositif scénique.
Quotidien abruti par le vide et la mièvrerie énoncées par des productions télévisuelles mais qui va s’animer pour être violemment renversé et mis en désordre avec une contamination du plateau par l’absurde.
Les inepties déversées par une sitcom et l’apathie de l’une des émissions de jeu les plus célèbres de France nous avertissent: le discours et la morale sont totalement vains, ne prennent pas ici, ils seront même ridiculisés.
La charge critique qu’amène le burlesque, cette morale de la tarte à la crème, rend l’homme petit et idiot comme les personnages dont les déplacements et les mots amplifient le vide de leur existence et leur absurdité dans ce monde. La déraillement de la machine décervelante montrera leur bêtise et leur méchanceté, voire leur cruauté, véritables ennemis auxquels s’attaque le genre comique.
La dadaïstes luttaient contre cela aussi, l’esprit de sérieux, la guerre surtout etc.. Pas discours mais de l’action, du concret.
C’est exactement ce qui se passe ici, une organisation « concrète » du désordre qui est orchestrée avec virtuosité. Tout discours est impuissant face à cette anarchie « fluide » , ce démantèlement du quotidien qui fait hurler la vie en créant du conflit, alors que tout était mort.
La représentante de la culture est le seul personnage produisant un discours avec ses interventions au bord de la scène, véritables logorrhées abaissant la langue à une novlangue de bureaucratie culturelle et municipale, doublant la charge critique du spectacle avec ces courroies labyrinthiques du monde de la culture -dossiers, partenaires, subventions, aides, élus etc..- rendues inaudibles, infernales et kafkaïennes. Cette incursion produit un effet comique dévastateur en parodiant une glose officielle inopérante, dont tout le monde se fout et qui semble abstraite dans le spectacle tellement le décalage avec la scène plombe littéralement ces interventions parlées et mettent à nu leur monstruosité. De côté, au bord, comme si ce discours ne pouvait pénétrer l’espace scénique car l’écart est tellement abyssal que les mots, le texte deviennent du nonsense, inutiles.
Les personnages sont figés dans leur rôle , répètent sans cesse les mêmes répliques et surtout agissent, mécaniquement, sans se poser de questions, toujours de la même façon, même lorsque l’ordre des répliques, des entrées est modifiée, les mots sont interchangeables tant on tourne à vide dans ce ménage infernal. De cette répétition éclate, pourtant rien n’est psychologique tout au contraire, une névrose terrifiante, la nôtre, du quotidien dans lequel nous sommes englués à notre rôle social en passant par ce que nous faisons par paresse de pensée.
Le désordre mis en scène fait éclater au grand jour cette absurdité qui nous conduit tous les jours, notre inconscient conformiste. Famille et culture sont brutalisées par ce renversement de la morale, qui fait du burlesque une morale de l’effondrement des valeurs et un révélateur de nos plus bas sentiments, de notre répétitive bêtise.
M.M
0 notes
Video
BRUTALISME
Présente en ouverture de la 7e édition du Festival "How to Love" (https://petitbain.org/how-to-love/) au @petitbain, la poétesse, militante et musicienne de Philadelphie Camae Ayewa n'a pas dérogé à l'esprit de son dernier album sorti il y a moins d'un an, l'occulte Analog Fluids of Sonic Black Holes.
La performance fut d’abord brumeuse, distante, Moor Mother ajustant son set derrière les machines, muette, laissant le field-recording de voix, des sons heavy-bass ou de percussions traditionnelles s’exprimer. Le décor posé, le verbe pouvait arrivé.
Au micro, Ayewa s’appliqua à dépecer brutalement la cadavre post-colonial et post-racial du continent américain. Le crime fut ample et parfait : violences policières -le terrifiant morceau LAPD 92- colonialisme, racisme, hypocrisie, armes à feu..le tout futt mis en pièces.
Des spirituals aux danses post-internet en passant par le free jazz, c'est un véritable laboratoire de la musique afro en live que propose Moor Mother. Ce collage souligne une démarche expérimentale et artistique très marquée par un discours politique qui s'appuie en grande partie sur le Black Power Movement tendance Black Panthers qui, ne l'oublions pas, était aussi un mouvement culturel, pensons à Amiri Baraka.
Plus le concert avançait et plus Ayewa nous entraînait avec ses expérimentations dans un univers apocalyptique post-industriel où les voix spectrales de spirituals, de discours ou de mélodies enregistrées apparaissaient puis disparaissaient tels des motifs de survivances, de résistances dans ce monde de ruines.
Enfin, restait une présence sur scène qui s’épaississait au fur et à mesure de la performance. Intenable, Ayewa se livra sans retenue , avec « brutalisme » pour emprunter le titre du dernier essai d’Achille MBembe, contre la brutalité du monde.
La performance de Moor Mother peut être aussi vue comme une tentative d’exorcisation de ce qui qui cause la douleur des hommes tant le rapprochement avec la transe est évident. Magique prouesse qui met en musique nos cauchemars pour mieux les prendre d’assaut.
M.M
0 notes
Video
BRUTALISME
Présente en ouverture de la 7e édition du Festival "How to Love" (https://petitbain.org/how-to-love/) au @petitbain, la poétesse, militante et musicienne de Philadelphie Camae Ayewa n'a pas dérogé à l'esprit de son dernier album sorti il y a moins d'un an, l'occulte Analog Fluids of Sonic Black Holes.
La performance fut d’abord brumeuse, distante, Moor Mother ajustant son set derrière les machines, muette, laissant le field-recording de voix, des sons heavy-bass ou de percussions traditionnelles s’exprimer. Le décor posé, le verbe pouvait arrivé.
Au micro, Ayewa s’appliqua à dépecer brutalement la cadavre post-colonial et post-racial du continent américain. Le crime fut ample et parfait : violences policières -le terrifiant morceau LAPD 92- colonialisme, racisme, hypocrisie, armes à feu..le tout futt mis en pièces.
Des spirituals aux danses post-internet en passant par le free jazz, c'est un véritable laboratoire de la musique afro en live que propose Moor Mother. Ce collage souligne une démarche expérimentale et artistique très marquée par un discours politique qui s'appuie en grande partie sur le Black Power Movement tendance Black Panthers qui, ne l'oublions pas, était aussi un mouvement culturel, pensons à Amiri Baraka.
Plus le concert avançait et plus Ayewa nous entraînait avec ses expérimentations dans un univers apocalyptique post-industriel où les voix spectrales de spirituals, de discours ou de mélodies enregistrées apparaissaient puis disparaissaient tels des motifs de survivances, de résistances dans ce monde de ruines.
Enfin, restait une présence sur scène qui s’épaississait au fur et à mesure de la performance. Intenable, Ayewa se livra sans retenue , avec « brutalisme » pour emprunter le titre du dernier essai d’Achille MBembe, contre la brutalité du monde.
La performance de Moor Mother peut être aussi vue comme une tentative d’exorcisation de ce qui qui cause la douleur des hommes tant le rapprochement avec la transe est évident. Magique prouesse qui met en musique nos cauchemars pour mieux les prendre d’assaut.
M.M
0 notes
Text
“On rencontre sa destinée souvent par les chemins que l’on prend pour l’éviter”
—
Jean de La Fontaine
(via scintillamincinere)

464 notes
·
View notes
Photo
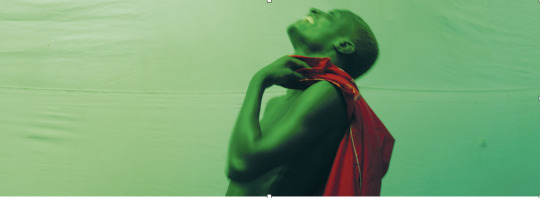
Ruines sublimées
« Si vous saviez sur quels tas d’immondices
Pousse la poésie, toute honte bue,
Comme la jaune dent-de-lion le long des clôtures.
Comme la bardane et l’arroche. »
Anna Akhmatova
Nickel
Jusqu’au 1er février 2020 au Nouveau Théâtre de Montreuil
avec Daphné Biiga Nwanak, Thomas Gonzalez, Keiona Mitchell, Julien Moreau, Snake Ninja, Romain Pageard & la communauté du Nickel Bar (15 à 20 amateurs.trices)
mise en scène Mathilde Delahaye
texte Mathilde Delahaye & Pauline Haudepin
Ruines sublimées
Le dernier spectacle de Mathilde Delahaye entraîne le spectateur dans un enchevêtrement de mondes différents et possibles en un seul et même lieu.
La dimension transformatrice en est l’axe principal, dans un mouvement en trois temps qui part d’un univers dystopique vers une utopie en passant par la création d’une communauté qui se lie aux marges de la société, aux bords du politique, des institutions, vers l’égalité.
Ce lieu est une usine russe, Norilsk Nickel sujet du documentaire de François Jacob datant de 2017, Sur la lune de Nickel.
Après un prologue reconstituant le genèse du projet et de l’usine, devant une imposante armature métallique la représentant, son dernier ouvrier se libère de son bleu de travail en se dénudant puis disparaît dans l’obscurité.
En lieu et place d’un récit diégétique autour du thème des ruines qui conterait l’histoire d’une usine jusqu’à sa fin tragique, Mathilde Delahaye choisit de nous montrer ce lieu avec d’autres agencements, d’autres aspirations; elle nous montre ses métamorphoses. Si bien que l’espace devient un espace topique, lieu de transformation et champ d’expérimentation de nouvelles formes de vies humaines.
Dans un espace si inhumain renaît donc la vie et la pensée-en-vie.
La première transformation sous nos yeux est d’une énergie folle, seule capable peut-être par son intensité à pouvoir arracher de la vie dans ce lieu qui se caractérise par l’absence de celle-ci depuis le départ du dernier ouvrier.
Un escouade d’une vingtaines de danseurs se fixe sur la scène, tous figés dans un tremblement elliptique au diapason d’une lumière stroboscopique. Leurs mouvements même modifient l’espace en piste de danse, soudainement et brutalement, le scène devient un club, la mutation est vertigineuse et elle se fait par les corps en fête. De la mort à la fête, métamorphose radicale, souffle nouveau, tempête de vie, l’énergie déborde du plateau. Il y a une double transformation : celle de ruines en un lieu festif et celle d’une horde en une communauté rassemblée autour de la danse. Car la chorégraphie aussi bien que les solistes venant du voguing propose des dispositifs circulaires, de défilés, de parades où le lien du collectif aussi bien que l’affirmation de soi par l’aspect performatif sont présents.
Nous comprenons que la modification d’un lieu s’accompagne d’un ré-agencement politique marqué par l’égalité.
Avant le troisième et dernier volet du spectacle, placés en hauteur dans une cabane mais filmés en portrait et projetés sur un écran en face de nous, des danseurs dialoguent où plutôt rêvent ensemble, se racontent, on est au bord du strorytelling, de la rêverie, la parole circule librement créant une polyphonie, celle-ci comme un prolongement de la chorégraphie où l’on existe avec les autres qui existent aussi.
La cabane, isolante et protectrice accentue l’intimité rendant possible la polyphonie et circulation libre de la parole. Elle fortifie aussi une communauté par la proximité des corps qui sont à l’origine d’une renaissance et d’une libération.
C’est un élément important du spectacle, sa politicité se fabrique moins par les mots que par les corps, elle est plus organique que philosophique, la pensée est engendrée par les rapprochements chorégraphique et polyphonique qui organisent intuitivement la communauté. C’est une pensée anti-dogmatique, contre une thèse unique où l’hybridité présente dans la communauté, dans les médias utilisés, dans le décor, création éphémère au statut précaire, s’affirme de plus en plus puissamment dans le spectacle.
Ce long intermède est lié au dernier temps de la création. Soudés par la polyphonie, installés dans une hybridation du monde, la communauté part en quête , comme un pèlerinage à la recherche de matsutakés , ces champignons japonais poussant sur les ruines d’Hiroshima et plus globalement sur les ruines du capitalisme industriel. Nouvelle mutation, nouvelle métamorphose de la communauté qui devient chercheuse dans un monde à nouveau végétal. L’image édénique vient à l‘esprit naturellement , on peut même pousser jusqu’à l’évocation du Pélerinage à l’ile de Cythère de Watteau , tableau illustrant là aussi un bonheur utopique.
Mais cet Eden n’est pas uniquement rêverie éthérée d’une pureté retrouvée, d’un retour à la terre. Il n’y a aucun romantisme dans cette utopie.
Evidemment, Thoreau est convoqué mais la recherche de ce champignon japonais qui raisonne comme une métonymie du spectacle ici intègre au rêve utopique une apparence scientifique, rationnelle donc concrète.
Comme Ovide, comme Kafka, Mathilde Delahaye nous montre la métamorphose, ce qui inclut frictions entre les êtres et hybridité. Dans son langage théâtral cela implique aussi une transformation de l’espace, une disposition des corps, un organisation de la parole sans hiérarchisation, créant un espace intime plus égalitaire, à l’abri de la violence du monde et plus libre.
1 note
·
View note
Photo

DE PEAU ET D’OS
ACTEURS !
conçu par Däper Dutto
avec Pascal Batigne, Maxime Chazalet, Lou Chrétien-Février, Juan Crespillo, Sylvia Etcheto, Julien Geffroy, Olivier Horeau, Isabel Oed, Sandrine Rommel
Jusqu’au 26 janvier 2020 au Théâtre d cela Commune d’Aubervilliers
Voici un objet théâtral rare et nécessaire. Le sujet se lit dès le titre-programme: Acteurs!, le point d’exclamation ne souligne ni étonnement, ni admiration mais concurrence plutôt le fameux action ! du cinéma, art également peuplé d’acteurs. Nous sommes placés au moment de l’action, du jeu sur la scène.
Paradoxalement, pas de scène ici ou du moins une estrade placée en biais face au public comme si le désir de tourner le dos aux dispositifs scéniques conventionnels. Pas de coulisses, seule une trappe d’où sera jouée une scène du Médecin volant par trois acteurs à la manière du Grand Guignol nous rappelle un artifice théâtral. Rien qui ne puisse nous détourner du sujet: les acteurs devant nous dans un espace vidé de références, de béquilles. Ceux-ci se présentent en tenues unies marron ou blanche et sandales renvoyant à une ascèse ou un pèlerinage, attirant le mystère.
Point de décor, point de costumes, point de mise en scène, la peau et les os de l’acteur survivent à cet appauvrissement volontaire de la scénographie. Nous observons un squelette que seul les acteurs pourront mettre en vie.
Bien plus qu’un hommage, on perçoit la volonté militante de cette mise en abîme de l’acteur, son désir d’effacer le metteur en scène pour remettre au centre l’acteur, le voir et non le regarder, et surtout le penser.
De quelle manière aborder un personnage monstrueux, peut-on jouir de ce rôle? Quel est notre rapport entre notre mouvement intérieur, de l’âme et l’extérieur, celui de la scène?
Ce qui est proposé c’est une pensée en actions avec des acteurs qui se questionnent, montrent leurs « trucs » , leur chemin dans l’appréhension d’un rôle, leur rapport avec le texte, leur rapport avec l’existence.
En décortiquant, par un ton démonstratif lors d’un prologue sous l’égide de Lacan, le regard est le premier avatar de l’acteur, être vu et son corollaire comment être vu. Descartes et son cogito ergo sum règle la question semble-t-il en permettant la vision de soi pensant.
Mais Lacan fait tout de même état d’un manque chez nous, être de regard, dans le dire et la vision Ce manque est ici la métaphore de l’acteur, chargé d’abord de jouer ce manque qui nous concerne tous ( il s’agit de l’inconscient) en le réduisant, le sculptant pour le montrer sur une scène. Mais surtout, ce manque permet l’avènement du nouveau à nos yeux, de la création .
Simplement, Acteurs ! en fait état, les textes canoniques (Hamlet, Molière, Oedipe-Roi) ne sont jamais joués de la même manière par un acteur, jamais. L’acteur révélant quelque chose d’invisible auparavant car manquant .
Ce travail expérimental, en même temps qu’il désacralise le métier d’acteur rend hommage à sa fonction de créateur. Rehaussant sa place dans la hiérarchie inconsciente et contemporaine où le metteur en scène est tout puissant.
Cet exercice anthropologique de la connaissance de l’acteur confirme leur nécessité pour l’homme car il dévoile ses ombres, libère ses pulsions et surtout agit sur notre manque en proposant de nouvelles perspectives de vision.
A l’opposé de la doxa par sa forme et son discours, les acteurs jouissent de la lumière projetée sur leurs expériences assimilables à une confession qui nous concerne tous. Ces expériences comme celles d’Acteurs! manquent que trop car elle mettent en mouvement notre pensée. Il serait dommage de rater une occasion de voir une pensée-en-vie.
Mathieu Méric
Photo: Copyright "Acteurs !" Isabelle Oed
0 notes
Photo

À L’EPREUVE DES ROBOTS
"CONTES ET LÉGENDES" une création théâtrale de Joel Pommerat
9 JANVIER — 14 FÉVRIER 2020 - NANTERRE-AMANDIERS
Le titre nous dit peu sur cette création de Jöel Pommerat, si ce n’est la continuité du compagnonnage d’une partie de son oeuvre avec cette forme de récit qu’est le conte.
À la suite du Petit Chaperon rouge, de Pinocchio, Cendrillon, comme le titre d’une anthologie destinée aux enfants, « Conte et Légendes » s’inscrit dans la (in)délicate saison de l’enfance.
Le motif du conte est indubitablement lié à une morale. Les protagonistes sont confrontés a des péripéties dont leur dépassement vaut leçon de vie. « Légendes » mot accolé à « Contes » nous situe dans des tentatives d’explication du monde, de sa création, par l’imaginaire.
Morale, connaissance du monde, imaginaire, trois axes structurants dans lesquels Pommerat peut déployer sa vigueur créatrice pour nous parler de nos comportements, nos moeurs, notre temps. Il faut bien le dire, Pommerat se fait moraliste.
Titre généralisant, forme littéraire protectrice très balisée, un schéma narratif bien huilé, une production normalement destinée aux enfants, tout cela donne l’illusion d’une oeuvre inoffensive, rejetée dans un imaginaire merveilleux qui agirait comme plaisant divertissement et nous éloignerait du réel.
D’une part, il ne faut pas oublier qu'au moins depuis Perrault, le conte possède des lectures psychologiques et politiques qui en font un genre sérieux. D’autre part, la réalité du plateau va logiquement dans ce sens et nous ressortons plus adultes, plus lucides et donc inquiets de ce spectacle.
Cette création est toutefois marquée par le remplacement du merveilleux par une entité qui se fait de plus en plus présente parmi nous: l’intelligence artificielle. De ce fait l’aspect anticipation est présent dans le spectacle placé dans un réalisme cru et brutal, si près de nous.
Dans ce cadre structurant du récit, Pommerat met en scène l’intrusion des robots dans le quotidien adolescent.
Cette immixtion sème un trouble et révèle un visage glacial de notre monde contemporain.
Mais « Contes et Légendes » n’est pas une production à thèse. Pommerat nous propose un théâtre de situations où l’ambiguïté et l’incommunicabilité dominent. Aussi, ces situations interrogent plus complètement nos valeurs, nos classifications traditionnelles.
Cette présence de personnages artificiels perturbe des socles bien ancrés dans notre société et la terre tremble sous ses garants. Les fondements sont attaqués, il y a des affrontements durant tout le spectacle.
Au fond, il s’agit plus d’un théâtre d’opérations que de situations tant c’est la guerre qui domine dans les relations entre les hommes; guerre entre humains et robots dans le champ du désir, semant un étrange sentiment de malaise car de l’autre côté, l’humain autrefois désiré révèle son ennui, ses impasses face à un monde de plus en plus confus.
Est-ce que les robots participent à cette confusion généralisée ? La réponse est plus fine et complexe. Il apparaît dans un comble d’ironie, relevant de la satire que le robot est le personnage le plus sage, avec le plus d’empathie au milieu du désordre familial, amoureux et générationnel. Et pour preuve, on lui laisse la garde d’enfants, de bébés. Il devient un icône de pop music au pouvoir quasi-thaumaturge dans la scène finale. On tombe en émoi amoureux pour lui.
Camarade idéal, il peut être réinitialisé en bonne à tout faire selon les volontés.
Et l’on en vient au sujet qui traverse cette création, la domination d’un être ou un groupe sur un autre être ou un autre groupe. Soumis aux vivants, les robots ne répondent qu’aux injonctions donc produisent une satisfaction immédiate qui facilite l’empathie à leur égard. Qui facilite leur exploitation aussi pour éviter la solitude, pour faire le ménage. L’homme se sert littéralement du robot pour panser ses plaies mais cela ne suffit pas tant elles sont béantes. Au lieu de régler nos vies, cette béquille artificielle les dérèglent, révèlent leur inanité et montre la nécessité d’un ailleurs,
La question de la domination que révèle le rapport vivants-robots provoque de violentes secousses dans des strates comme la famille et le genre. Tout explose soit insidieusement avec cette scène viriliste où un encadrant chasse la différence chez un garçon en l’humiliant devant une meute qu’il a façonné , soit nerveusement avec cet adolescent dont la mère a quitté le foyer et qui s’occupe de ses frères en bas âge faisant face à la situation et l’attitude d’un père absent et lâche. On atteint le pathétique quand une famille souhaite acheter un robot d’occasion pour s’occuper des tâches ménagères car la mère ne sera plus là pour officier.
En corollaire à cette société qui perd son masque et dévoile ses rapports de domination, la patrie adolescente ne se laisse plus berner : la révolte du fils qui remplace la mère, la colère face à la situation familale au moment d’acheter un robot. Eux, nous montrent de réels sentiments, une réelle exaspération, une réelle violence dans le langage qui accrédite la thèse d’un monde où les relations se distendent car l’autre est devenue plus que proie ou ennemi. Leurs réponses peuvent nous troubler, c’est certain, mais elles expriment la violence qu’ils reçoivent et le désir-refuge de trouver un espace hors du champ de bataille.
Comme dans tout conte, les sarcasmes, l’ironie laissent la place au véritable visage d’un monde terrifiant et appelle à plus de consistance et d’humanité en montrant que l’inhumain nous le fabriquons tous les jours. A tels points que les robots seront plus humains.
Mathieu Méric
0 notes
Text
Beau parcours de l'#exposition #Boltanski "Faire son temps" au @centrepompidou .
Après avoir traversé les premières œuvres de l'artiste liées aux restes de son enfance puis son obsession des portraits : anonymes, d'abord, puis bourreaux et victimes mélangés, puis victimes toutes seules. Jusqu'aux mausolées précaires pour les morts de la Shoah. Après cette plongée progressive dans les ténèbres (métaphore du passage à l'âge adulte?), une lumière cathartique, un tintement qui berce notre contemplation. Il n'y a plus personne , nous sommes seuls face a horizon infini et lumineux. Après l'Enfer, le Paradis?
https://www.instagram.com/p/B7RhxpNo28PTspE00vsYE95SIcPVR6Sj9dAwSQ0/?igshid=xds82liywea1
0 notes
Photo










“mais c’est vraiment trop étrange cet opossum sur son coeur “
296 notes
·
View notes
Photo

RETOURNER LA LANGUE, RETROUVER LA PUISSANCE
« Perdre le Nord »
de et par Marie Payen au Théâtre du Rond-Point jusqu’au 29 Décembre.
La performance de Marie Payen dans la salle Topor au Théâtre du Rond-Point porte des paradoxes dont les frictions rendent le geste lumineux : Dire le tragique tout en étant salvatrice.
Dans une lumière enténébrée qui nous transporte aux limbes hantés de spectres d’innocents vivants ou morts, elle s’avance avec pour seule protection dans cet espace infernal une robe longue traînée de fortune sur la peau. Reine déchue, sortie d’un conte terrifiant, l’actrice partage avec humilité dans une courte introduction, la genèse de son travail avec les exilés.
Cette élégie qui embrasse tous les damnés de la terre quittant leurs racines, leur maisons, leurs proches pour survivre à la misère, aux vicissitudes du temps, est avant tout une expérience du dire. Dire l’effroi, Dire l’enfer des exilés.
Mais ici le dire accouche d’une autre langue, il vient subvertir toute structure langagière connue. Ainsi, nous sommes orphelins de repères, nous entrons en errance dans une forêt de signes avec pour guide un coryphée des âmes damnées.
C’est l’expérience de la perte des sens, de l’habitus, qu’accompagne la naissance de cette « lingua incognita » surgissant de la voix endeuillée de l’actrice. Un nouveau monde de rhapsodies soutenue par une musique improvisée en direct sourde mais très présente qui sait traduire aussi une mer fracassée avec son ressac de vagues en quête de Rédemption.
Dans cette tempête qui devient connaissance par les gouffres et aborde l’expérience de l’exil par la destruction de repères, par un tissu narratif sans cesse effiloché, nous approchons plus intensément et surtout plus grandement le destin sensible de ces corps torturés, poétisés par Marie Payen.
Des râles, des croisements de langues, un monologue d’un enfant à naître, une interview rapportée, un épuisement de la langue qui désoriente, sème la terreur dans nos esprits cartésiens. Une langue en action totale, sans pudeur. Une poésie en marche violemment vivante où Marie Payen se métamorphose en chaman organisant l’ouragan. Les mots obtiennent alors un pouvoir qui permet de renverser la perspective de la question migrante. De sous-hommes au seuil de la mort nous assistons à leur transformation par une langue poétique anarchique qui n’aspire qu’à embrasser, déflorer le vivant. Plus que de la dignité, c’est de la puissance qui est transmise ici. Rien de figuratif, de descriptif mais une traversée dans la langue remplie d’une énergie destructrice et rédemptrice. Beau et dévastateur.
Mathieu Meric
0 notes
Photo

Intense Fortunio !
À l’Opéra-Comique jusqu’au 22 décembre.
Fortunio
Comédie lyrique en quatre actes d’André Messager. Livret de Gaston Arman de Caillavet et Robert de Flers d’après Le Chandelier d’Alfred de Musset. Créé à l’Opéra Comique en 1907.
Direction musicale, Louis Langrée
Mise en scène, Denis Podalydès
Avec Cyrille Dubois, Anne-Catherine Gillet, Franck Leguérinel, Jean-Sébastien Bou, Philippe-Nicolas Martin, Thomas Dear, Aliénor Feix, Luc Bertin-Hugault
Choeur les éléments
Orchestre des Champs-Élysées
À lire le programme de la soirée, on s’attend à une bouffonnerie narrant une histoire badine dans laquelle un barbon provincial se fait cocufier par un soldat de passage en garnison. Un marivaudage sans prétention qui disserte de manière légère sur les caprices de l’amour. Un peinture sous forme de farce d’un milieu provincial et bourgeois où les règles du mariage ne suivent pas celles de l’amour.
Las ! Il n’en est rien ! Cette comédie lyrique, avec ses demi-caractères -personnages pittoresques, milieu bourgeois, grivoiserie- possède la fluidité et le mouvement rythmé tirant vers le comique. Celui-ci servi par la remarquable prestation de Louis Langrée et l’Orchestre des Champs-Elysées en parfaits compagnons de la scène avec une musique nerveuse sans cabotinage, très alerte et légère.
Franck Leguérinel incarne un maître André sur lequel repose l’essentiel de l’aspect comique de la pièce. Barbon dépassé, il espionne Jacqueline par jalousie. Son aveuglement et son idiotie le font passer à côté de sa vie. Décalé, toujours en retard de l’action, il ne fait que subir sans le savoir chaque évènement de la pièce. On est dans le schéma de l’arroseur arrosé, tout comme le capitaine Clavaroche. Faux stratèges, vrais ridicules.
Mais Louis Langrée et l’Orchestre des Champs-Elysées servent aussi une densité et une force nécessaire faisant accélérer les mouvements de coeur dans le décisif Acte III.
Car, cette comédie de 1907 est adaptée de la pièce Le Chandelier de Musset et par cela nous savons par avance que le sujet des infortunes de l’amour est traité avec plus de profondeur qu’une grivoiserie teintée de sentimentalisme.
Le goût artistique de l’époque est au « nervosisime » fin-de-siècle selon l’expression de Paul Bourget. Contre le naturalisme, on recherche le Beau, de la pureté d’âme, un absolu intense, hors les règles de la société donc souffrant, malade, mélancolique…
Musset, disparu cinquante ans auparavant, et son bestiaire de monstrueux amoureux romantiques est revenu sur le devant de la scène grâce à ce goût pour le décadentisme, cette alliance de la Beauté et de la maladie qui caractérise l’époque fin-de-siècle.
Tiré du Chandelier, Fortunio est un héros romantique noir, plus Werther que tout autre gracieux et vivace héros romantique français. Le tempérament ténébreux et suicidaire de Fortunio éclate lors de l’Acte III, lorsqu’il s’effondre à genoux, pris de convulsions épileptiques au moment même où Jacqueline succombe à la pureté de son amour.
Les décors d’Eric Ruf accompagnent bien ce chemin que prend la comédie vers une intense énergie noire, avec sobriété et élégance par de subtils détails rappelant par le mouvement des saisons, et les reflets de l’âme du héros instable, fragile, que l’amour consume.
Cyrille Dubois excelle dans ce rôle de héros blessé de nature, incapable d’adaptation au monde qui l’entoure, incapable d’aimer sans passion dévastatrice. Tête basse, éploré, il est l’opposé névrotique de l’hyperactif Maitre André. Dans ce jeu de tensions Jacqueline alterne entre frivolité et gravité tant l’émotion s’empare du plateau lors de l’aveu de Fortunio. Personnage le plus dynamique incarné par l’épatante Anne Catherine Gillet, le personnage de Jacqueline malgré un bovarysme certain, développe une subtilité psychologique de la passion amoureuse, tantôt attirée par la liberté et transie devant la pureté des sentiments du héros.
Fortunio est une oeuvre beaucoup complexe et subtile qu’elle ne laisse paraître et la mise en scène de Podalydès appuie un romantisme noir qu’elle porte en elle. La musique de Messager, qui fut le directeur musical du Comique tout en étant admirateur Wagner, restitue à merveille ce centrage romantique dans la comédie lyrique, tableau vif d’une esthétique consciente de son a-moralité et assoiffée d’idéalisme.
Mathieu Méric.
1 note
·
View note
Photo

Impressions #8
ITEM, Théâtre du Radeau
Jusqu'au 16 décembre au T2G-Théâtre de Gennevilliers
"ITEM" : Une poétique des crises.
Ecrire que le Théâtre du Radeau nous embarque dans un univers singulier propice à la dérive rhapsodique, au dépassement de tout barrage entre rêve et réalité transformant le temps en matière liquide, où l’on rame pour atteindre une cohérence interne et restituer un cap dans une mer de signes, relève du pur pléonasme. Il est entendu que nous sommes bien au théâtre et que c’est uniquement les différents vents rugissants de la scène qui mènent la barque. François Tanguy s’échine depuis le début de l’aventure a élaborer artisanalement une langue proprement théâtrale dans sa fabrique. Un théâtre théâtral, ou bien de l’espace théâtral. Il s’agira donc d’observer comment le metteur au scène traite la question de la représentation.
Avant de décortiquer le squelette du navire, amarrons nous sur le titre, qui est provisoire, donc incertain, flottant, appelé à évoluer voire à disparaître; ITEM est en sciences de l’information un retour du message dans le principe d'une communication en boucle, aspect pour lequel un message survient.
Cette définition ouvrirait la piste d’ un spectacle qui s’obstinerait à énoncer le même message. Et ce, de manière circulaire et répétitive.
Il y a bien des fils inter-textuels, des liens ténus qui tissent une figure héroïque malade du monde à sauver et jetée dans la folie, bien incapable d’agir efficacement alors qu’on lui réclame à la fois de la grandeur et de se taire. Paradoxe d’une figure épique, le héros, ici traitée comme un être tourmenté, parodique.
Cette récurrence de la figure du héros a son noyau. C’est le prince Mychkine, l’idiot christique de Dostoïevski qui traverse la scène et nous emporte dans la tempête sous son crâne.
Ce héros oxymorique, indigent, pauvre est abandonné des Dieux et ne semble atteindre aucune Providence. Au contraire, il est rabroué, coupé, traité comme un enfant ou pire, comme un saltimbanque :" -(…) Si ça se trouve, c’est un grand charlatan pas un idiot.
- Sans doute que oui, je le vois depuis longtemps. C’est dégoûtant de sa part de jouer la comédie. Il veut gagner quelque chose ou quoi, en faisant ça? »
La posture sincère, « C’est notre sincérité qui vous fait peur(…) », de l’homme providentiel recherchant le Bien est reléguée au rang de piètre comédien démasqué.
L’idéalisme est donc bien suspect ici et le héros perd tout attribut valeureux, noble, il se change en personnage qui doute dans un monde de plus en plus labyrinthique, personnage qui qui n’assume plus sa fonction antique , pire, est en proie à des crises qui concentrent tout le malaise d’une civilisation en perte de direction. « L’Idiot » est le texte-noyau du corpus d’ITEM, la première scène du spectacle avec un monologue illustré des peintures fait directement écho au choix de sujet de tableaux, loisir auquel s’adonnent les personnages du roman de Dostoiëvski ainsi qu’à la le genèse du roman, la vision hallucinée, et préparatrice du roman, de l’auteur du Christ mort (ou Le Corps du Christ mort dans la tombe ou encore Le Christ mort au tombeau) peinte par Hans Holbein le Jeune entre 1521 et 1522.
La crise du héros et son corollaire, l’excroissance du Mal, sont bien ici au coeur du spectacle. Et ce dernier l’emporte comme le signifie la ballade tragique de Marie Sanders en fin de spectacle. Le Mal triomphe à tel point que de la compassion naît chez le Diable qui n’ a « (…) même plus envie de tourmenter ces malheureux (humains). »
Revenons au titre pour plonger dans la carcasse du navire que nous appelons ici plateau. Pourquoi ? Car, la scène nous préserve de cette victoire du nihilisme et de la négation , car ITEM signifie dans sa forme adverbiale un ajout, un plus, un « aussi », une autre chose.
Une lecture linéaire nous propose donc la crise d’une civilisation et notre impuissance à y remédier. Notre aveu de maladie. Mais l’esthétique du Radeau guérit le spectateur par une autre crise. Fragmentée, faite de superpositions de récits et discours enchâssés dans un récit-cadre, avec une scénographie qui met l’accent sur ces empilements, imbrications entre textes différents (autre chose) , ajoutant une perception d’enchevêtrement d’une profondeur infinie qui nous fait basculer dans l’irréel, le rêve. Scénographie qui participe au dérèglement d’un récit linéaire, qui brise toute emphase pathétique avec ses contraintes matérielles imposées aux acteurs, avec des cadres, portes, tables aux tailles et allures différentes qui participent d’une mise en crise de la représentation.
C’est bien ce qui est recherché aussi, un plateau en crise, dans le jeu d’acteurs, sans pathos, avec césures, dans un corps maladroit aux déplacements mécaniques. Des personnages tragiques qui se servent de la raison « pour être plus bête que n’importe quelle bête. » dixit Mephistophélès. La présence constante du comique chez l’acteur perturbe une narration tragique sans fond dans une atmosphère très pesante, chargée d’émotions dans laquelle est prêt à éclater le plus horrible, le plus indicible, comme l’enchevêtrement musical parfois bruitiste, mais peu souvent apaisé, nous le rappelle. Comme si nous étions au bord d’un gouffre et qu’à ce moment-là, au lieu de bravoure c’est la vanité qui ressortait des âmes.
Nous sommes bien dans la satire avec cette ironie permanente des acteurs qui participe à ce mélange de genres mettant à distance le spectateur de cet horrible mal qui les ronge.
Peinture des caractères, des passions à travers une poétique de la crise du héros, de l’homme, de la représentation, d’ITEM se dégage un rappel du tragique de l’existence, sans morosité, sans violence, sans amertume, simplement avec art.
Mathieu Méric.
0 notes
